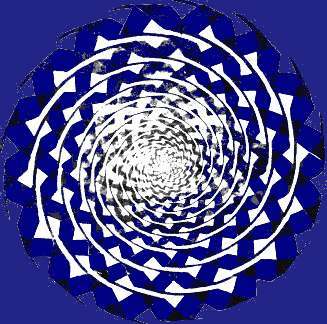Bordeaux Juin 40 au jour
le jour
Par Bertrand FAVREAU

Une chronologie

Bordeaux Juin 40
Par Bertrand FAVREAU
(Extraits)*
I LE CHOIX
DE BORDEAUX
1. 14 juin : L installation
2.
15 juin :
Armistice ou Capitulation ou Non cedant arma togae
3. 16 juin : se battre ou ne pas
se battre
1.
L installation
Le 14 juin, tandis que les troupes allemandes d filent dans
Paris d sert, le gouvernement de la France roule vers Bordeaux. Bordeaux depuis
le d but de juin est une ville engorg e, asphyxi e, touff e. La population de
la ville avait connu son apog e en 1921 en approchant les 270.000 habitants.
Mais depuis le dernier recensement de 1936, la capitale girondine s' tait
accoutum e ne dispenser ses douceurs aquitaines qu' ses 258.341 habitants.
Or, Bordeaux qui avait mis cent ans pour tripler sa population jusqu' 1921 et
dont, depuis le d but de l'entre-deux-guerres, l'agglom ration tait la seule
cro tre pour atteindre 400.000 habitants, a doubl ou tripl en quelques jours
seulement. D j en septembre 1914, pour un trimestre, promue capitale, la ville
avait connu un afflux de population subit. Mais il n'avait t que vingt cinq
ou trente mille. A peine un dixi me de la population. Combien taient-ils s'y
engouffrer en juin ? Nul ne le saura jamais. Faute d'avoir pu compter on a cit
les chiffres les plus incertains ou les plus improbables. 800.000, 1.500.000 ou 1.800.000 pour
l'ensemble de l'agglom ration, dans une ville dont les services taient con us
pour en abriter six fois moins ?
Dans les premiers jours de juin, c'est le peuple du d sastre
qui s'est d vers dans la ville. Il ne faisait que pr c der ou accompagner la
derni re vague : celle des politiques. Les familles de ce que l'on appelle pas
encore les r fugi s ( on parle alors de "repli s" ou
d'" vacu s") belges comme les familles de r fugi s fran aises qui
sont venues les rejoindre depuis de longs mois. La ville est devenue
impraticable D sormais ce ne sont plus de luxueuses limousines, ou des
immatriculations trang res qui p n trent dans la cit . Ce sont des voitures
h t roclites portant un capharna m d'objets divers, couvertes de matelas sur
les toits, boucliers d risoires contre les stukas en piqu e qui attaquent les
convois entiers
Pourtant le pr fet d j donne l ordre aux
r fugi s de se replier sur la Haute-Garonne, l Ard che ou l H rault et aux
Luxembourgeois vers la C te d Or. Devant le consulat de Belgique, 84, rue
Juda que, devant la pr fecture, rue Esprit des Lois attendent d'interminables
files. Il n'y a Bordeaux qu'un Consul marchand, Monsieur Grange, ancien agent
commercial de l'industrie sid rurgique Li geoise. C'est un octog naire.
La ville qui est apparue comme le dernier refuge de la libert est en tat de
si ge. La ville depuis longtemps d j avait vu sa qui tude troubl e. C tait en
r alit la troisi me vague des assaillants qui allait d ferler sur elle. Ce
furent d abord les fortun s avec leurs luxueuses voitures. Puis d s le 20 mai,
les premiers r fugi s belges et luxembourgeois. Ils sont accabl s par les
malheurs de leur pays : la capitulation du roi des Belges les a
constern s, l accusation de trahison par Paul Reynaud les a achev s.
Un des premiers arriv s, le maire d'Anvers, Camille Huysmans
a charg ses concitoyens Roger Avermaete d'organiser l'accueil des r fugi s
dans un bureau du rez-de-chauss e de l'H tel de Ville qui donne sur la cour
int rieure. Un nouveau Consul est nomm , Raymond Herremans partir du
20 mai. D s son arriv e, il d crit
la plus grande confusion: une chancellerie exigu , encombr e, bruyante,
litt ralement assi g e par la foule des r fugi s .
Depuis le 22 mai, les Belges et les Luxembourgeois sont chaque
jour plus nombreux. Au lendemain de la capitulation de l'arm e belge, la
longue cohorte des voitures immatricul es en Belgique sont entr es dans la
ville. Ils sont accabl s par les malheurs de leur pays : la capitulation
du roi des Belges les a constern s, l accusation de trahison par Paul Reynaud
les a achev s. Elles ont t aussit t rejointes par les r fugi s du nord et de
l'est.. Depuis le 22 mai, le maire a ordonn la fermeture des salles de
danse et interdit les bals. Depuis le 27 mai les journaux ne paraissent plus
que sur deux pages. Depuis le 6 juin on a rationn l eau qui n est distribu e
en permanence que dans les rez-de-chauss e et les premiers tages. Le Baudoinville sur lequel le
gouvernement belge repli va tenir un Conseil des Ministres s'est amarr fin
mai dans le port de Bordeaux. La ville est devenue impraticable Le 28
mai sur le tender d'un train arriv en gare Saint-Jean, les r fugi s belges
avaient crit: Vive la France, notre seconde patrie . Tandis que son
gouvernement est Poitiers, le ministre de l' conomie belge a lu domicile
Bordeaux depuis le 16 mai. Ses bureaux ont t ouverts dans une petite maison
de la rue Blanc-Dutrouilh, puis dans le cadre plus luxueux du Ch teau Labotti re
o une grande salle du premier tage abrite tout la fois les services de la
justice et celui du personnel d'Afrique.

Le
Baudouinville dans le port de Bordeaux.
Une telle foule n'est plus contr lable. Le Ministre de
l'int rieur prend un arr t obligeant tous les r fugi s de Belgique, de
Hollande et du Luxembourg, entr s en France depuis le 10 mai, se pr senter
aux autorit s, sous peine d'internement. Le 24 mai, on limite au
d partement de la Haute-Garonne, de l'Ard che et de l'H rault, l'accueil des
r fugi s belges, qui sont invit s quitter imm diatement le d partement.
Le 26, une circulaire t l graphique du Minist re de l'int rieur, interdit la
circulation de tout v hicule automobile en provenance de Belgique, Hollande ou
Luxembourg, ayant servi au transport des r fugi s h berg s en Gironde, et
oblige les parquer sur des terrains dont ils ne peuvent tre retir s que sur
autorisation sp ciale. On demande que soient des agents et des
officiers de la police belge la disposition des autorit s fran aises. sur la
surveillance de gendarmes belges en uniforme du pays. A Bordeaux et dans tous
les centres, des milliers de voitures furent parqu es en plein vent dans des
champs. Les propri taires ne recevant qu'une d charge sign e par un
pr pos Les voitures se mettent jusque dans les garages priv s. Le 10 juin, les
r fugi s sont somm s de quitter Bordeaux et un p rim tre de 20 kilom tres
autour de Bordeaux, avant le 13 juin midi, dernier d lai. Il s'agit de faire de
la place. Le Gouvernement fran ais a quitt Paris. Le 12 juin la Croix-Rouge
am ricaine a t transf r e Bordeaux.
De jour en jour la situation
militaire s tait aggrav e. Le 25 mai un mot tragique avait t prononc pour
la premi re fois : armistice. Mais c tait alors par le génél Weygand et
lors d un conseil de guerre. On a beaucoup discut depuis de l ant riorit .
Weygand affirmera que Reynaud a lui-m me prononc le mot le 29 mai. Pourtant,
d cid agir, Paul Reynaud avait annonc Jeanneney le 30 mai qu il voulait
en finir et constituer un vrai cabinet de salut
public , regroupant tous les ministres d cid s continuer la lutte
jusqu au bout. Passant l acte, le 5 juin, alors que les derniers soldats
venaient d embarquer Dunkerque, il vin a Daladier et d cida de prendre
lui-m me en charge le quai d Orsay, o il nommait Paul Baudouin en qualit de
sous-secr taire d Etat. Yves Bouthillier devenait ministre des finances en
remplacement de Lamoureux. Jean Prouvost directeur de Paris-Soir et de
Paris-Match, prenait l information et Frossard les travaux publics en
remplacement de Monzie. Tous ces nouveaux
nomm s allaient tre des partisans de l armistice, l exception d un génél
de brigade titre temporaire nomm sous-secr taire d Etat la d fense
nationale, charg des liaisons avec la Grande-Bretagne : le génél
Charles de Gaulle. Le 11 juin Briare, Reynaud, P tain et Weygand avaient
rencontr Churchill. Au cours de ce conseil supr me, Weygand avait dit
Nous sommes au dernier quart d heure . L hypoth se du r duit
breton se r duisait d heure en heure.
Le gouvernement devait quitter Tours. Il tait
pourtant divis . A la fin du mois de mai, Mandel avait dissuad Paul Reynaud,
d opter pour la solution du r duit breton : on ne peut pas gouverner
la France depuis Brest. Mandel avait une id e : aller vers la capitale de
la Gironde. Non seulement parce que c tait le d partement dont il tait l lu,
mais parce qu il y avait un pr c dent : nous avons t Bordeaux
en 1914 et cela ne fit pas de mal. Et il avait ajout :
c est commode pour l Afrique du Nord .Contre un point de vue
contraire, c est le cas de Camille Chautemps. Reynaud a d cid
finalement en faveur de Bordeaux, la Bretagne apparaissant impraticable en
raison de l avance allemande vers l ouest. Comme d habitude, c est l opinion de
l entourage qui l a emport dans son esprit et pour celui de :
Bordeaux, au contraire, tait certainement la ville de France la plus mal
choisie pour tre le si ge du pouvoir public en un pareil moment. Lorsqu'il
s'ajourna, 11 heures et demie, dans la nuit du 13 au 14, le second et dernier
Conseil de Cang n'avait pris qu'une mesure effective: il se transporterait le
lendemain Bordeaux.
[ ]
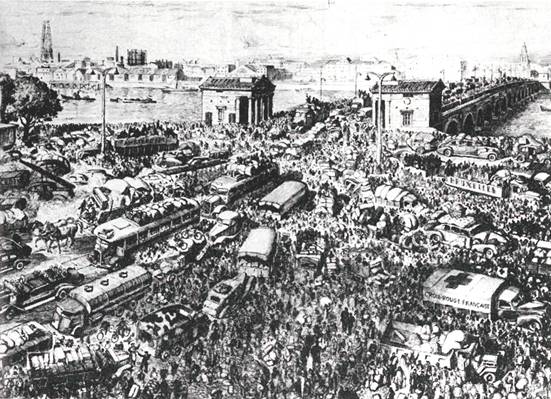
Bordeaux. Le Pont de Pierre. Juin 1940. Eau forte de Charles Philippe.
Vendredi
14 juin 1940. Le pr fet de la Gironde a t
charg de pr parer l installation du gouvernement et de tous ceux qui vont
l accompagner. Au sous-pr fet de Libourne, Blaye et Langon, il a adress une
circulaire tr s secr te du Ministre de l Int rieur leur
enjoignant de rester leur poste. M me si un ordre de repliement de la
population est donn par l autorit militaire. Vers minuit il a demand au
génél Lafont, commandant la 18 me r gion militaire, de faire assurer
la garde de tous les immeubles et h tels qui vont tre occup s par le
gouvernement. Sur un plan strictement quantitatif c est onze cents personnes
qui vont se replier de Tours Bordeaux, n cessitant la r quisition de trois
cents bureaux. Le seul ministre des Affaires Etrang res a trois cent
cinquante de ses fonctionnaires loger et il y a les ambassades et l gations
qui suivent les pouvoirs publics. D s 2 heures du matin le 14
juin plusieurs de ses collaborateurs ont t re us par le secr taire
génél de la Gironde. Ensemble, ils tudient les possibilit s de logement des
ministres et de leurs services. Ils y consacrent toute la nuit .
Le 14 juin, partir de 16 heures, le génél Lafont
a du se frayer un difficilement un passage sur le Pont de Pierre
pour aller la rencontre du cort ge officiel. Ce seul pont sur la
Garonne, est un goulot d tranglement . Paul Reynaud est arriv
Bordeaux vers 17 h. L amiral Fernet charg du logement l a install l h tel
du commandant de la 18 me r gion militaire, rue Vital-Carles ( le
génél doit se r fugier son tour dans les locaux de l caserne de la
rue de Cursol). A la m me heure, le Pr sident de la R publique, Albert Lebrun,
sera install , dans la m me rue, quelques pas de l , dans la r sidence du
Pr fet, 17, rue Vital-Carles. D sormais, la rue Vital Carles, clos de
silence et d immobilit ou champ clos d un combat qui s annonce, est
gard e par des cordons militaires ses deux extr mit s. Les curieux
stationnent dans les rues avoisinantes l aff t des nouvelles. Un barrage
laisse passer les voitures des ministres qui se rendent la Pr sidence de la
R publique, l H tel du Pr fet, ou la Pr sidence du Conseil. Et pour les
badauds trangement insouciants l attraction est la Rolls-Royce de l ambassadeur
d Angleterre Sir Ronald Campbell. On a plac la Chambre des d put s dans
l' cole Anatole-France, derri re les jardins de l'h tel de ville, et le
S nat dans l'ancienne salle des Bouffes bordelaises , qui abrite le cin ma
Capitole, rue juda que. Le S nat-cin ma dira Jeanneney.
Une heure apr s pr c d e de
motocyclistes, la caravane minist rielle traversait son tour le pont. Mandel
a d j retenu sa place dans les locaux administratifs de la pr fecture de la Gironde,
rue Esprit-des-Lois, qui faisait aussi l'objet des convoitises de Paul Reynaud.
Le Minist re de la D fense Nationale est l H tel de Ville. La
vice-pr sidence du conseil et le sous-secr tariat d Etat aux r fugi s la
facult des lettres, cours Pasteur. Le Minist re de la Guerre est dans l'annexe
du lyc e de jeunes filles rue Vital-Carles. Le Minist re de la Marine et de la
Marine Marchande a t install l'Ecole de Sant Navale cours de la Marne.
Les Minist res des colonies, air, armement comme le Minist re des Travaux
Publics et des Transmissions, se partagent les locaux la Chambre de
Commerce et du Port Autonome, au Palais de la Bourse. Le Minist re des Affaires
Etrang res est au Lyc e de Longchamp (avant de d m nager la Facult de
droit). Le Minist re de la Justice au Palais de Justice, place de la
R publique. Le Minist re des Finances et celui du Commerce la Direction de
l Enregistrement, place du Champ de Mars. Le Minist re de l Agriculture et du
Ravitaillement aux abattoirs, quai de Paludate. Le Minist re de l Education
Nationale au lyc e de gar ons de la rue Sainte-Catherine, le Minist re du
Travail la Division D partementale des Assurances Sociales cours Anatole
France, et le Minist re des Anciens Combattants et de la Famille Fran aise
l Institution des Sourds Muets, rue Abb de l Ep e. Le minist re du travail
sera h berg par les Assurances sociales (2, rue de Toulouse-Lautrec). Les
transmissions, aux PTT, rue du Palais-Gallien, les pensions dans la
maison. des anciens combattants, 97, rue de Saint-Gen s ; la production
agricole la facult de m decine, les services de deux ministres
d Etat Louis Marin et Jean Ybarn garay, finissent dans les locaux de l Ecole
sup rieure de Commerce rue Abb de l Ep e.
Il fallait tenter de loger tout le monde. Il n y a
que 450 h tels Bordeaux, de qualit tr s diverse, mais il n y a plus une
chambre. Elles ont t r quisitionn es. On installe le cabinet de Paul Reynaud
l h tel Splendid sur la place des Quinconces, avec le ministre des
finances, Bouthillier ce qui met c te c te Baudouin (qui fait partie du
cabinet de Paul Reynaud) et Bouthillier. Les personnalit s de la
R publique avaient obtenu des logements particuliers. Herriot, prend ses
quartiers dans un h tel princier , cours Xavier-Arnozan donnant
sur un jardin l anglaise . Le Mar chal P tain est sur le
Boulevard Wilson, dans un h tel particulier, entour d un parc, 304, boulevard
du Pr sident, Wilson. Mais le propri taire Monsieur Desbarats, est
absent et c est la concierge qui va accueillir le mar chal et lui pr ter
"ses plus beaux draps".
Installer les minist res n' tait pas loger les ministres.
Ils devaient tre r partis dans divers h tels du centre: les ministres
d' tat, Louis Marin
et Jean Ybarn garay l'h tel
Normandie, le vice-pr sident du Conseil Camille Chautemps et les
sous-secr taires d tat aux r fugi s, Robert Schuman au Royal Gascogne,
rue de Cond , le ministre de la justice, S rol au Bordeaux, celui
des travaux publics, L.O. Frossard. au Continental, ministre des PTT, et
ministre du commerce Chichery, l'h tel de Nice, Rollin,
ministres des colonies, et M Rio, ministre de la marine marchande, l'h tel
des Grands- Hommes. Le Ministre de l' ducation nationale, Yvon Delbos, est
l'h tel de Bayonne. Le ministre de l'air, Laurent-Eynac, l'h tel de
S ze et celui du Blocus, Georges Monnet, l'h tel des Quatre-Soeurs. Mais
d'autres, moins heureux, sont exil s dans le quartier de la gare excentr et
expos en cas de bombardement : Queuille, ministre de l'agriculture, est au
Regina (o il ne s'attarde d'ailleurs pas), C sar Campinchi, le ministre de la
marine et Rivi re, ministre des pensions l h tel du Faisan, en
face de la gare.
La soir e du l4 juin est d'abord pour certains,
l instant des d convenues. C est la rencontre avec l'inconfort. Tous les autres
sont dans des logements chez des particuliers, dont ils d couvrent le confort
incertain d es logements occasionnels dans une ville de province souvent
inf rieur aux normes auxquelles ils sont accoutum s. Ainsi, l amiral Fernet a
accompagn Jules Jeanneney jusqu son logement r quisitionn cours
Xavier-Arnozan. On lui dit qu il s agit de l ancienne demeure de la reine
Am lie du Portugal. Mais le Pr sident du S nat n'en a cure car il est horrifi
par l'h tel particulier. Il n en supporte pas la premi re vision : couloir
froid, salon luxueux et d mod , poussi reux et d penaill . Son
effroi s accro t en d couvrant au deuxi me tage des lits baldaquin armori s,
sans matelas, et des toilettes sordides . Epouvant il fuit et
trouve refuge d s le lendemain, au 22 rue Cast ja, chez un cousin loign , le
chirurgien Georges Jeanneney, alors mobilis , apr s s tre
r fugi une nuit au Splendid.
Le Splendid, dont le
hall tait constamment encombr de 100 150 personnes. , l'h tel de
Bordeaux, et son Grand Caf , l endroit o se r unissaient tous les r fugi s de
la capitale, " avec ses colonnes, ses guirlandes, ses glaces, ses plafonds o
gambadait un olympe pour Offenbach, parlaient de bonheur et de gourmandise
" et le restaurant du Chapon fin, "salle
qui tient de l aquarium et du jardin de rocaille , vont devenir les
lieux incontournables de la trag die qui se joue Bordeaux.
Peu peu les d put s vont arriver. 87 d put s
et 44 s nateurs sont pass s ou ont r sid Bordeaux entre le 14 et le 20 juin
1940, d'apr s les d comptes des services de la pr fecture. Des parlementaires
d couvrent qu'ils "rel gu s" dira l'un d'eux - l'h tel
Terminus : Vincent Auriol, Le Troquer, Scapini, Spinasse Tessan,
Maroselli, de Wendel, Bardoux. Paul-Boncour install chez Oscar
Delor, 56, rue de Tivoli; Ramadier, 56, avenue d'Eysines au Bouscat et
le s nateur de Grandmaison . Arcachon la "villa Saint-Fran ois
Xavier". L on Blum est arriv trois heures du matin dans la nuit
du 15, Georges Mandel devra lui procurer en catastrophe une chambre.
Le
soir nous arriv mes Bordeaux. C tait la foule de Tours mais plus grande,
dans une ville plus vaste. C tait le lieu o
convergeaient tous les repli s de France. Les Bordelais taient
int ress s, applaudissaient le corps diplomatique raconte le diplomate
Jean Chauvel. Ainsi, l ambassadeur des Etats-Unis est install
Haut-Brion Pessac o tait venu Jefferson quelques cent cinquante ans plus
t t. Celui d Argentine chez l industriel Souillac Caud ran, non loin du Parc
Bordelais. Les services de l ambassade de Grande-Bretagne iront au ch teau
Filhot Sauternes, mais seront compte-tenu de l loignement, aussit t cumul s
avec ceux du consulat de Bordeaux rue d Enghien, pr s des Quinconces.
L ambassade d Espagne est en r sidence au ch teau Carayon-Latour
Saint-Michel-de-Rieuffret, celle du Japon au ch teau Prost Barsac, celle de
Pologne au ch teau de la Roche Blanche Floirac, celle d URSS au ch teau des
Tours Montagne et celle de Chine au ch teau Lagrange Saint-Julien-de
Beychevelle. Le nonce apostolique sera au ch teau Tessonneau Tresses tandis
que Barsac accueillera la l gation du Canada, celle des Pays-Bas et celle de
Su de. A Sauternes on trouvera la l gation suisse au ch teau Guiraud, celle de
Turquie tandis que la l gation du Portugal, celle de Panama, d Irak, d Irlande,
du Luxembourg, du Mexique, d Egypte et de Monaco iront dans des ch teaux de
Saint-Emilion.
Arriv s 19 h. Bordeaux, l ambassadeur
Campbell et le major génél Spears ont eu la r v lation de ce que le plan leur
avait r serv le ch teau Filhot dans le sauternais. Ils en appellent Mandel
pour que leur soit r serv es dix chambres l h tel Montr afin d installer des
services d sormais superpos s Bordeaux de l ambassade et du consulat. Aux
yeux du génél Spears l h tel situ entre le cin ma Fran ais et le March des
Grands Hommes, a un immense avantage : il est situ en face du restaurant
Le Chapon Fin qui est pour Spears le meilleur d Europe . C est l
qu ils se rendent le soir m me. Dans ce restaurant d crit par Spears comme
une salle qui tient de l aquarium et du jardin de rocaille , ils
mettent un plan strat gique, la premi re des pages d histoire qui s y criront
au cours des journ es venir. C est au cours de ce d ner sous l il vigilant
de Joseph Sicard, qui les observe, le regard inquiet derri re sa barbe blanche,
les deux convives vont convenir d un pacte.
Du 14 au 28 juin, pendant quatorze jours,
toute l France va d ferler Bordeaux. On y trouve Jean Giraudoux, Marc
All gret, Andr Gide, Edmond Jaloux, Saint-Exup ry, l air d un chat boudeur , selon Julien Green.
"Tout ce que Paris et la France a compt comme puissants de personnalit
ou de vedettes se retrouvent Bordeaux. Devant la porte de la radio, rue
Ernest Renan, on voit surgir Louis Jouvet, Jean Renoir, Madame Simone."
En cette soir e du 15 juin, peu de bordelais
ont sans doute vu une silhouette abattue, sortie de la rue Vital Carles, pour
s'engouffrer Cours de l'Intendance. Comme chaque soir, Bordeaux, le Pr sident
de la R publique Albert Lebrun " prouvant le besoin de
prendre l'air apr s des journ es si remplies de soucis" se dirige vers
les Quais. "Immenses, les quais, la tomb e de la nuit, m ritait ce
nom de bordel dans le rapport phon tique avec celui de la ville avait toujours
t tr s clair. Sous les fen tres clair es de leur belle maison,
bouillait une fi vre, un d sordre, une luxure indescriptible".
La Garonne, garnie de navires (il y a 400 navires dans
le port) est "en livr e de guerre". Mais ce soir l , Lebrun voulait "deviner travers les saluts chang s et les
propos entendus l' tat d'esprit des promeneurs". Il songeait plus que
jamais la visite qu'il avait re ue l'apr s-midi de Charles Reibel, juste
avant le Conseil des Ministres. Il lui avait dit en sanglotant : "Est-il un jour plus tragique que celui o
les chefs militaires refusent de se battre ?".
Ce m me soir apr s s tre install au 304
Boulevard Wilson, dans l h tel de Monsieur Desbarats, le Mar chal P tain s est
rendu dans la bousculade l h tel Splendid pour y prendre son repas. Il a d n
en compagnie du docteur M n trel et de son officier d ordonnance, le capitaine
Bonhomme. Install l'h tel Majestic, 2, rue de Cond , (comme Baudouin
qui r cup rera finalement le logement affect au ministres des affaires
trang res, 58, rue de Saint Gen s), le génél de Gaulle, secr taire d'Etat
depuis quelques jours, arrive 22 heures au Splendid pour s'y restaurer. Le
directeur Maurice Pujo, lui fait pr parer un frugal repas en l installant
c t de la table o le mar chal P tain prenait son d ner Il s avan a
vers lui et lui serra la main. Sans
un mot notera le génél dans ses M moires, ajoutant : je ne devais plus le
revoir, jamais .
Ce soir l , au cin ma Fran ais on donne La glorieuse
aventure en v.o. sous titr e avec Gary Cooper compter du jeudi 13
juin. C est l histoire pique d une poign e d hommes toujours inf rieurs en
nombre mais jamais vaincus qui luttent vaillamment pour arracher leur
ind pendance ceux qui cherchaient les r duire en esclavage.
[ ]
2
Bordeaux Juin 40 au jour le jour
Par Bertrand FAVREAU
I LE CHOIX DE BORDEAUX
1. 14 juin : L installation
2. 15
juin : Armistice ou Capitulation
3. 16 juin : se battre ou ne
pas se battre
2.
Armistice ou Capitulation
[...]il
semblait, cette nuit l ,
que tous les gouts
de France avaient d bord
et que leur infect
contenu s coulait dans la belle ville,
en une abominable
inondation
Major génél E. L. Spears
T moignage sur une Catastrophe
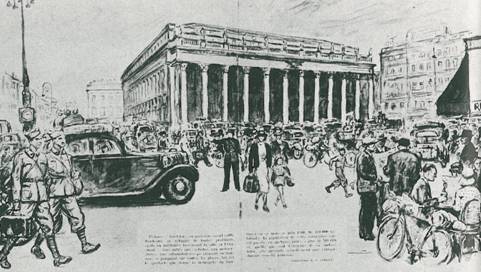
Bordeaux.
La Place de la Com die en Juin 1940. Dessin de J. Simont.
Samedi 15 juin
1940. Depuis la fin de mai, le d bat
s' tait engag mots couverts. Le mot fatal : armistice n avait t
l ch qu au Comit de guerre du 25 mai, puis le 29 mai, dans une lettre de
Weygand Paul Reynaud. D j , Weygand avait envisag l impossibilit de
continuer une lutte militaire . A-t-il ensuite en accord avec P tain, parl
d'un armistice ? Officiellement, plus rien jusqu'au 5 juin. Puis, il y e t le
Comit de guerre du 5 juin, auquel participaient Reynaud, P tain, Weygand,
Darlan et Baudouin. Ce jour-l , une violente discussion s'instaura entre Spears
et les Fran ais propos de l'insuffisance de l'appui britannique. Premier
pr texte pour Weygand, approuv par le mar chal P tain, d annoncer clairement
alors que si la bataille est nettement perdue, le v ritable courage ce
moment-l sera de traiter avec l'ennemi . Seul Reynaud avait dit alors
qu'aucune paix et qu'aucun armistice ne seront acceptables . Au Conseil
supr me interalli de Briare, le 11 juin, avait d but la grande querelle. Paul
Reynaud s tait retranch derri re l'accord franco-britannique du 28 mars et
l'engagement qu'il avait pris envers Churchill, Briare, de ne rien faire sans
le consulter. D j , une nouvelle querelle s'instaurait: qu'avait dit exactement
Churchill? Avait-il oui ou non d li la France de son engagement de ne pas
conclure de paix s par e? Il fallut attendre la veille du d part vers Bordeaux
pour que le probl me f t explicitement voqu . Et, Bordeaux, elle allait
occuper le devant de la sc ne.
Car les probl mes non r solus Tours allaient se reposer
dans des termes identiques Bordeaux. Tours avait marqu la fin du r duit
breton : Weygand avait t sans appel: le r duit breton tait impraticable.
Quant la th se d fendue par Mandel : Se battre. s'il le faut
jusqu'aux Pyr n es , se battre en Afrique du Nord , m me en reculant, s'il
le faut, jusqu' Tombouctou , Weygand y avait d j r pondu : Je ne vais pas
chez les n gres
Le choc Reynaud-Weygand
Quelque f t l ampleur de la catastrophe militaire, plusieurs
solutions s offraient. Ou bien un simple ordre
de cesser le feu, comme l'avait fait, d s le 15 mai, l'arm e hollandaise, sans
aucune signature, sans convention quelconque avec l'ennemi, sans responsabilit
d'un gouvernement, qui quittait le territoire. Avec la reine. Ou bien un armistice, qui exige un engagement gouvernemental avec participation des
militaires, ce qui fut fait en 1871.Ou bien encore, une capitulation, sign e par le chef de l'arm e, comme venait de le
faire, le 27 mai, le roi des Belges en tant que génélissime des arm es, mais
non en qualit de roi.
De capitulation, il n'est pas question pour le génél Weygand
(Weygand psalmodiait qu il ne signerait jamais quand on lui
donnait l ordre de capituler). De paix, il n est pas question dans l esprit de
Paul Reynaud, car pour sauvegarder l'avenir, la d cision de cesser le combat
m tropolitain devait n avoir qu'un caract re militaire. D vidence, Churchill,
qui avait affirm dans son discours du 4 juin que l'Angleterre ne capitulerait
jamais, voulait voir les Fran ais r sister par tous les moyens : par une
d fense acharn e dans les villes, par la gu rilla dans les montagnes et les
for ts, par l'envoi du maximum d'hommes en Afrique du Nord, o ils recevraient
de l'armement britannique et am ricain, et surtout par l'utilisation de la
toujours prestigieuse flotte fran aise. Au demeurant, il n y avait pas de
discussion envisageable puisque la France tait juridiquement et moralement
engag e par l'accord franco-britannique du 28 mars 1940, ne signer ni
armistice ni paix s par e.
Le génél de Gaulle ne songeait pas la gu rilla, peu
pris e par les militaires l poque, mais le choix du r duit
breton , d un transfert vers l'Afrique du Nord, voire le refuge en
Angleterre, apporteraient haut et clair la d monstration que la France
continuerait la guerre. C tait aussi la th se de Louis Marin, de C sar Campinchi
et de Georges Mandel. Paul Reynaud bien qu en bute aux assauts journaliers de
Mme de Portes, de Paul Baudouin, du colonel de Villelume, et de tous les
pacifistes de son entourage, partageait sinc rement cette opinion, mais avec
moins de vigueur.
Si l'on refusait tout armistice, il fallait bien admettre
que ce qu'il restait d'arm e capitulerait. On ne para t pas avoir song une
lutte jusqu'au bout o la reddition des soldats se ferait titre personnel,
ou, mieux, par un cessez-le-feu unilat ral, comme cela avait t le cas en
Hollande, et non par la signature d'une capitulation officielle impliquant les
g n raux. P tain et Weygand en t te avaient horreur de toute capitulation, car
elle est interdite et punie de mort par le Code de justice militaire. La pr cision
n tant pas la chose la mieux partag e en ces journ e de juin, tous deux
paraissaient confondre le cessez-le-feu unilat ral et la capitulation n goci e
avec l'ennemi Dans ces suggestions, ils ne manquaient pas de voir une attaque
sournoise des civils contre le prestige et la p rennit de l arm e. Etonnante
projection pour qui conna t la suite de l histoire.
A leurs yeux l'armistice pr sentait moins d'inconv nients.
L'armistice est génélement sign par des militaires, mais au nom du gouvernement. Ainsi l'honneur
des g n raux resterait-il sauf. Au surplus, m me dans les conditions
dramatiques o se trouvait la France, elle garderait, gr ce pr cis ment la
flotte et l' Empire , quelques atouts pour la n gociation. L'inconv nient
tait qu'au lieu de liquider la bataille sur le seul territoire
m tropolitain, l'armistice arr terait les op rations pour l'ensemble des forces
de la France. Si on le signait sans l'accord des Anglais, on manquerait la
parole solennelle donn e le 28 mars 1940.
Au grand d bat Armistice
ou capitulation ? , le discours d faitiste agr geait des
variantes secondaires. Weygand annon ait une in luctable et imminente d faite anglaise : Dans trois
semaines, l Angleterre aura le cou tordu comme un poulet proph tisait-il,
en cette forme, ou avec des variantes, ce qu il ne manquera pas de contester avantageusement
par la suite malgr les t moignages concordants. Au point que cela devint une
croyance largement reprise par les partisans de l armistice : il s'agissait
bien alors de la fin de la guerre et non pas de la perte de la seule bataille
de France.
Un autre question lancinante et sournoise nourrit
l anglophobie naissante que l ambassadeur Campbell et le génél Spears vont
ressentir Bordeaux : l Angleterre
a-t-elle t un alli loyal ? Elle n a envoy qu'une dizaine de divisions.
Elle a refus de baser en France la plupart de ses escadrilles. Elle a
rembarqu Dunkerque les britanniques avant les Fran ais, sans oublier
l'entre-deux-guerres et le spectre de Fachoda, de Waterloo et autre Jeanne
d Arc Devant une pareille d faillance, quelle peut tre au vrai la valeur de
l'accord sign inconsid r ment - le 28 mars par Paul Reynaud ?
La troisi me id e qui hante les esprits d faitistes est que l'arm e allemande, par d finition irr sistible, une fois les Pyr n es atteintes, n'aura
aucune peine traverser l'Espagne, jusqu' Gibraltar d'o elle gagnera
sans encombre sur la c te africaine, le Maroc espagnol. Et de l , l'Afrique
fran aise du nord, puis le reste de l'Afrique, qui, d pourvue d'armes, devaient
s' crouler leur tour. Le m me proph tise que la Wehrmacht atteindra
rapidement Suez, frappant ainsi au c ur de l empire britannique.
Ce sont ces arguments crois s qui vont s affronter Bordeaux
avec violence. Et le conflit va rev tir une apparence humaine en la personne de
deux hommes : Paul Reynaud et Maxime Weygand. Weygand a 73 ans, Reynaud n en a
que soixante deux.
Depuis Briare, Weygand, le militaire, n'a qu'une doctrine :
Pas de d shonneur pour les armes ! . Reynaud, lui, est
l arch type du parlementaire. Plus encore c est un avocat, profession
embl matique de la R publique et r servoir naturel de son personnel politique.
Les f es se sont pench es sur son berceau. Les lauriers de la richesse ont
pr c d les honneurs du barreau. Gendre d Henri-Robert, le
b tonnier-acad micien, secr taire de la Conf rence du Stage, il a t lu en
1919 avec le raz de mar e bleu horizon dans le d partement o il tait
n : les Basses Alpes. Mais tout autant qu avocat, Reynaud est parisien dans
l me. En 1928, il est devenu d put de la 2 circonscription de Paris et n a
cess d tre r lu depuis. Et chaque matin sur la place du palais Bourbon o il
habite, ses volets s ouvrent sur l entr e de la Chambre des d put s. Pourtant,
au-del de ce tableau conventionnel, le s millant et mondain, Reynaud
d concerte. L histoire a retenu avec d rision les contrastes de ses
proclamations en forme d apophtegmes contre temps qui ont scand les tapes
du d sastre de 1940, elle a oubli que l orateur fut d abord reconnu pour sa
modernit d conomiste, pr conisant avant la lettre la d valuation, quand
Laval, au milieu des ann es-trente, pr chait et appliquait la d flation. Mais
ce mod r ne fut pas mod r ment r publicain et a tenu d s ses premiers
pas placer son action sous l gide du chef du gouvernement de d fense
r publicaine , le grand Waldeck-Rousseau, auquel il rendait hommage dans
son discours de rentr e la Conf rence du Stage du barreau de Paris. Sinc rement
oppos l armistice malgr la fatigue nerveuse que lui a impos e son
entourage, il a t parlementaire quand il fallait un h ros et il a choisi le
calcul court terme plut t que le choix de l histoire. Mais il est un des
rares avoir eu le courage, contre son lectorat naturel, d accepter une
alliance avec les forces du front populaire, convaincu, depuis 1937, qu il
fallait lutter contre Hitler avec n importe puis d tre aux cot s de Mandel et
de Champetier de Ribes au nombre de ceux qui ont envisag de d missionner
l instant des accords de Munich en septembre 1938. Et s il ne fut peut tre pas
l homme qu il a d crit dans les trois versions successives de ses M moires
entre 1946 et 1962, il eut aussi le m rite insigne de sentir, de ressentir et
de pressentir dans les conceptions pr monitoires du génél de Gaulle le profil
de l homme le plus proche de ce qui f t conviction profonde. C r monieux et
protocolaire avec le génél en chef jusqu au 14 juin, il va l affronter
plusieurs reprises le 15 et le 16. Sous la distinction parfaitement ourl e des
mots percera la violence. Au-del de l ternel d bat entre la parole et
l action, Bordeaux, entre le militaire et l avocat, ce fut un moment du
combat entre les armes et la toge. Reynaud a sans doute - comme il l a crit
sinc rement envisag de renvoyer Weygand, mais c tait au moment o il n avait
plus les moyens de le faire. D aucuns lui reprocheront de ne se les tre point
donn s. Et c est Weygand qui l a bris .
Les parlotes du 15 juin.
Pour les partisans de l armistice comme pour ses
adversaires, le 15 juin devait tre la journ e de la d cision. Comme les
pr c dentes la journ e allait commencer t t au cours de cette nuit au plus
profond de laquelle le génél de Gaulle quittait une premi re fois Bordeaux
pour une mission Londres vers la Bretagne et Plymouth. Quelques instants
apr s, trois heures du matin un personnage essentiel est arriv lui aussi
Bordeaux, accompagn de Marx Dormoy. Qu est ce qui m y appelait :
L angoisse et le sentiment de mon devoir[...] Je sentais l heure si
p rilleuse que je ne me reconnaissais pas le droit de me tenir l cart
dira t il dans ses M moires.
.. A trois heures du matin au d bott il fait
irruption la Pr fecture de la Gironde . Dans la capitale girondine
surpeupl e qui s efforce de chasser ses premiers r fugi s pour lib rer les
places au profit des politiques , il n y a plus une chambre. Apr s avoir
envisag de dormir dans leur voiture, ils ont song qu la Pr fecture il avait
le, ministre de l Int rieur et que ce ministre tait Mandel connu pour recevoir
aux heures les plus improbables de la nuit. Mais trois heures du matin, cette
nuit l , Mandel vient justement de se coucher. Heureusement quelques
secr taires veillaient encore et leur donn rent des billets de logement pour
l H tel de Normandie qui jouxte la place des Quinconces deux pas du Splendid
o dormait Paul Reynaud et que venait de quitter le génél de Gaulle, apr s
son dernier salut protocolaire et froid au mar chal P tain.
D s six heures du matin, le lendemain, apr s peine trois
heures de sommeil, Georges Mandel est le premier en action, h ve et non ras
, ainsi que le d couvrira Jules Moch, son premier visiteur de la matin e.
Mobilis mais investi d'une mission Bordeaux aupr s de l'amiral Darlan, Moch,
lui aussi a song qu il fallait consulter Mandel dont la r putation de
sp cialiste m rite des pointages n est plus faire. Or Mandel justement a
besoin des socialistes. Il le dit Moch. cette heure, il y aurait depuis
Tours, selon lui huit ministres s rs partisans de la r sistance : Reynaud,
Marin, Campinchi, Laurent-Eynac, Dautry, Rollin, Thellier et lui. (Il juge Rio
incertain ou Moch l oublie dans son num ration tardive). Et tr s proche d'eux,
le socialiste Georges Monnet. En revanche, seraient d finitivement acquis la
capitulation outre l in vitable P tain, Chautemps, Rivi re, Frossard,
Ybarn garay, Pomaret, Chichery, Bouthillier et Prouvost, soit neuf au total.
Mais le sagace Mandel n'arrive pas situer la position de trois autres :
Delbos, et S rol. L on Blum pourra agir favorablement, s'il en tait besoin,
pour renforcer la fermet de son ami socialiste, Monnet et de Delbos, radical
dont il est l'ami et le voisin. Plus encore, il pourra chapitrer S rol, jug
incertain, mais aussi le troisi me membre socialiste du gouvernement, Albert
Rivi re, qui n tait pas encore Bordeaux cette heure mais devait arriver
pour le Conseil de l apr s midi. S'ils se rallient la R sistance, celle-ci
peut l'emporter , commente-t-il l'attention de Moch ". Cette r union
n tait qu un pr lude de l aube. La vraie r union de combat se tiendrait plus
tard.
Entre temps, les partisans de la
cessation du combat ne seront pas rest s inactifs. A 8 H 45, Paul Baudouin
s est rendu sur le Boulevard Wilson, chez le Mar chal P tain qui l a fait
appeler. Le mar chal est clair : les conseils des ministres successifs ne
sont que dilatoires. Il est d cid en finir . Il fait demander Paul
Reynaud une r union urgente. Paul Reynaud plus que jamais cartel entre des
pressions contradictoire propose 18 heures. Le Mar chal insiste. On transigera
sur seize heures. A 10 H 30, dans le quartier de l H tel de Ville et dans le
quartier de la barri re de Pessac comme aux alentours du Lyc e Longchamp, les
partisans de la cessation du combat avaient pr vu, eux aussi, une r union.
L une d entre elles est pr vue 10 H 30. La veille, son Q G, le génél
Weygand a re u un message clair de la part du Mar chal P tain :
Il est
question de faire r unir un Conseil des Ministres Bordeaux demain la fin de
la matin e.
La pr sence du
génél Weygand est n cessaire.
Le Commandant en
chef devra tre Bordeaux 58, rue de Saint-Gen s au domicile de M. Baudouin,
t l 868-20, avant 10 H 30
Le génél qui affirmera avoir inform du message et de sa
venue Paul Reynaud (qui sans doute l aura oubli ) ne sera pas au rendez-vous.
Avant qu il ne parte avait t prise la d cision de reculer le quartier génél
...Vichy. Et le 15 7 heures du matin le train sp cial mis sa disposition
pour lui permettre de quitter le si ge du Quartier génél au ch teau du
Muguet, pr s de Briare pour rejoindre Bordeaux n avait pas pu d passer
Ch teauroux. Il n arrivera la gare de la Bastide qu 14 heures. Presque en
m me temps que son fid le Charles Reibel. 1 0 h 30 se tient une r union dans
le bureau de Mandel. On y trouve, outre Louis Marin, les radicaux Campinchi,
ministre de la Marine dont la conviction n est plus faire mais aussi Queille,
Laurent-Eynac, le ministre de l'Air, Laurent-Eynac, Thellier, mais aussi
Queuille. L on Blum qui s y rend n y voit ni Louis Rollin que Jeanneney qui s y
rend comme Herriot, entend verbeux , ni Frossard
catastroph selon Jeanneney qui y survient comme Herriot.y fait
une apparition. Ce qui importe au premier chef L on Blum Jeanneney l a
constat c est de savoir l tat exact des arm es. La conversation dans
laquelle je me trouvais introduit me plongea soudain comme dans un monde
nouveau pour moi et o tout m accablait de stupeur se souviendra-t-il.
Il y apprit en effet ce qu il ignorait : Tours le mar chal P tain,
vice-pr sident du Conseil et le génél Weygand, commandant en chef s taient
tous deux prononc s pour la suspension imm diate des hostilit s. Les
deux soldats les plus glorieux de France dont l un commandait l arm e, dont
l autre la personnifiait au sein du gouvernement demandaient, exigeaient
presque que la France d pos t les armes . Jeanneney pr tend avoir
synth tis la position marino-mand lo-campincho-reynaldienne :
L arm e est en d route : c est certain. Mais ce qu'il en "este,
s'emploie-t-on vraiment l'employer ? Voil le drame. De bons l ments
d'aviation subsistent (Laurent-Eynac confirme). Une flotte intacte n'a encore
t engag e nulle part. Il y a encore l'Empire dont on vantait tant nagu re les
ressources et les m rites ! Il y a enfin nos alli s, envers qui nous sommes
tenus... Ce n'est rien cela ?
Selon L on Blum, tous les hommes r unis ce matin l dans le
salon de la Pr fecture s levaient avec la m me d cision contre
l attitude des chefs de l arm e. Et L on Blum de leur dire : En
r sum [...], vous tes tous d accord pour r sister, mais vous pensez qu
l heure pr sente l unique forme de la r sistance est le d part ? .Conclusion
de l'entretien : il convenait de d cider le d part des pouvoirs publics hors de
France pour continuer la lutte. A condition que chacun tienne bon. Pour
Jeanneney, ce n est qu une parlote de plus , laquelle il conc de
cependant un aspect positif : Herriot y aurait manifest beaucoup de
rondeur et de r solution .
Des chefs militaires refusent de se
battre
A 11 heures, Baudouin se rend chez le Pr sident du Conseil.
D j le mar chal P tain a entrepris son si ge. Il le trouve en compagnie de l ambassadeur
Charles Roux dans le bureau du chef du gouvernement. Selon Baudouin, le
mar chal r p te inlassablement son antienne : cessation des combats sans
d part des pouvoirs publics l tranger. Reynaud, que Baudouin, consid re mou
dans la d fense de ses positions s en tient la position de la
veille : pas de d cision avant la r ponse de Roosevelt l ultime appel
qu il lui a adress dans la nuit de jeudi vendredi. Le mar chal menace de
d missionner. A la m me heure Jeanneney se rend chez Reynaud avec Edouard
Herriot.
A quatorze heures, Weygand arrivait finalement en gare de La
Bastide sur la rive droite de la Garonne. Il rejoignait imm diatement Baudouin,
pour un conciliabule entre avec P tain, Darlan et Bouthillier. L Baudouin
donne une arme contre Reynaud aux conjur s : il leur affirme qu Tours
Churchill aurait d clar comprendre la p nible n cessit ou va tre la France
de demander l armistice . Reynaud serait donc selon lui d li de son
engagement du 26 avril. La voie est libre pour la conclusion d une paix
s par e.
A la m me heure que Weygand, un personnage de second plan
mais dont l agitation n est pas n gligeable est arriv en voiture
Bordeaux : c est le s nateur Charles Reibel, l ami de Weygand. Il se rend imm diatement
l'h tel du pr fet, rue Vital-Carles, transform pour la circonstance en
Elys e de fortune aupr s de Lebrun pour lui d crire l tat effroyable des
troupes qu il a recueilli aupr s de Weygand qu il a rencontr la veille
Briare. En a t il re u la mission ? Lebrun ne dira rien de cet entretien.
Pourtant, le pr sident, en guise de r ponse Reibel qui proclamait : Je
vous retrouve en des circonstances tragiques , a bien situ
l exact enjeu de ces journ es : En effet, est-il un jour plus tragique
que celui o les chefs militaires refusent de se battre ? . Reibel
s installe ensuite dans la cour de l h tel de la Pr fecture, et interpelle un
un les ministres lors de leur arriv e pour le Conseil des Ministres de 16
heures.
La v ritable altercation verbale - la premi re - aura lieu
15 h 45. Weygand entre d un pas de chasseur dans le bureau de Paul Reynaud, Rue
Vital Carles, investi de la mission qu il a re ue de P tain : il faut en
finir. Il veut un entretien seul seul. Le discours est toujours articul en
quatre branches : militaire : situation catastrophique aggrav e.
Tactique : exigence d un armistice imm diat. Humanitaire : souffrance
des soldats et mis res des r fugi s. Politique Risque de troubles génélis s. Paul
Reynaud est d accord sur un point : il faut arr ter la tuerie. Les deux
hommes ne diff rent que par les moyens. Weygand exige un armistice. Reynaud
annonce avoir choisi la m thode hollandaise . Etre la reine
Wilhelmine et pas le roi L opold. Il convient donc que le cessez le feu
mane du génélissime. L armistice ne pourrait tre qu une d cision des
politiques. Une capitulation ? Jamais il n acceptera de jeter une telle
honte sur l arm e fran aise. Je vous donnerai un ordre crit
pr cise Paul Reynaud. A l armistice, il oppose la n cessit d une capitulation,
pr lude une continuation de la lutte en Afrique du Nord. Reynaud est
formel : Weygand r pond :
-
Le gouvernement ne peut
pas quitter la France.
Et comme Reynaud lui objecte que l Alg rie c est trois
d partements fran ais. Il coupe s chement :
- Ce n est pas la m me chose . De toutes fa ons, la
doctrine de Weygand est bien arr t e et celle l il ne la contestera point
puisqu'il la r p tera m me dans sa d position au proc s de Riom - :"D t-on
me mettre les fers aux pieds, je ne quitterai pas le pays".
Mais l Weygand n est plus militaire, il est maurassien. Il
ne supporte pas l insoutenable outrecuidance d un pr sident du conseil de la
gueuse : Un monarque peut partir l tranger, il repr sente
toujours un pays sur lequel sa dynastie r gne de p re en fils. Que repr sente
donc en comparaison un pr sident du Conseil de cette troisi me R publique qui
en a d j compt plus de 100 en 70 ans ?
De cet entretien Paul Reynaud tire une tardive
conclusion : Je rel verai le génél Weygand de son
commandement, le jour m me, apr s le Conseil des Ministres ! La
d cision sera prise... sept ans apr s dans ses M moires en 1947. Pour l heure
le Conseil n a pas encore commenc et sans doute Reynaud mesure t il mieux le
15 juin 1940 qu en 1947 combien il est impossible pour le chef du Gouvernement
de limoger le génél en chef d arm es tron onn es et en d b cle qui recueille
le total appui du vice pr sident du conseil, le Mar chal P tain.
L incident a retard
le Conseil pr vu pour seize heures. Reynaud et Weygand ont du en quelques
minutes peine remonter la Rue Vital Carles pour se rendre s par ment - en
l h tel du Pr fet o doit se tenir le premier Conseil des ministres de
Bordeaux. Il commence 16 h 15. L amiral Darlan et le génél Weygand y sont
introduit. Darlan sans rien trahir de ses sentiments profonds voque les
op rations navales en M diterran e. Une nouvelle fois, Weygand, plus pond r
que lors de ses prestations pr c dentes, donne des nouvelles du front. Apr s
avoir investi Paris, les Allemands se dirigeaient l'ouest, vers vreux et la
Bretagne, l'est ils fon aient sur Saint-Dizier et Troyes. Le Rhin avait t
franchi, et les troupes qui garnissaient la ligne Maginot allaient tre prises
revers. Sans doute soucieux d' viter d' tre d menti, Weygand ne se livre plus
lui-m me des annonces sensation. Il laisse intervenir le génél Lafont,
commandant de la XVIII r gion militaire, qui venait apporter des nouvelles de
plus en plus catastrophiques au Conseil. Ce sera un message du génél Georges.
Peu avant 17 heures, Weygand et Darlan sont invit s se retirer. Paul Reynaud,
lit alors ses ministres la r ponse de Roosevelt son t l gramme du 10 juin,
puis insiste sur le devoir de la France de rester en guerre. Paul Reynaud,
propose alors ses ministres, puisqu'il n'est plus possible, de l'avis des
militaires, de combattre sur le sol de France, de suivre l'exemple du
commandement hollandais et de proclamer le cessez-le-feu . Un armistice est
un accord et on ne peut raisonnablement envisager un armistice avec
Hitler, pense Paul Reynaud. Il ne reste donc qu une solution : L arm e
capitulera sans condition. Il oppose ceux qui exaltent les souffrances des populations
et des soldats l'effet imm diat de la solution hollandaise , alors qu'une
demande d'armistice exigerait avant une conclusion plusieurs jours de
n gociations pendant lesquels le massacre ne pourrait que se poursuivre.
.
Pris un instant leur propre logique, les partisans les
moins politiques de la cessation du combat semblent se rallier la solution
hollandaise. L'adh sion apparente de P tain est au moins suffisante pour qu'il
soit charg par le Conseil d'aller, hors s ance et sans d lai, convaincre
Weygand dans le salon d -c t que cette issue n'est aucunement contraire
l'honneur militaire. Et qu'il accepte la mission soit qu il y voit la fin
laquelle il aspire, soit qu il pense qu elle balaiera avec elle un gouvernement
investi aux seuls fins de faire la guerre . Mais, quelques minutes plus
tard, P tain revient en s ance: non seulement il n'a pas convaincu Weygand,=,
lequel attend toujours, - en compagnie de Darlan - dans le salon voisin. Qu'a
bien pu dire P tain ? A-t-il tent de convaincre Weygand que le choix d'une
telle issue ne serait aucunement contraire l'honneur militaire ? Nul ne saura
jamais les mots qu il devait prononcer pour accomplir sa mission ? Weygand
n en parlera jamais.
Quelques minutes plus tard, P tain revient en s ance : non
seulement il n'a pas convaincu Weygand, mais il a t litt ralement retourn
, selon le mot de Lebrun, par lui. En faction dans la pi ce contigu de la
salle de r union, le génélissime, sentinelle impassible veillant sur
l'honneur de l'arm e, exigeait, plus que jamais et sans d lai, que le
gouvernement d cid t de l'armistice. Et avec lui de sa chute inexorable
puisqu il a t nomm pour faire la guerre. Le d bat reprend. Une longue
discussion s ensuit crira Paul Baudouin. De cette discussion que
savons-nous ? Certaines positions sont d sormais bien connues : P tain,
Ybarn garay, Pomaret, Bouthillier, Prouvost et Baudouin (sous-secr taire d Etat
qui n est pr sent qu en qualit de secr taire du Comit de guerre et qui ne
vote pas) prennent fermement position en faveur de l'armistice. Ils sont
combattus par Marin, Monnet, Dautry, Campinchi, tandis que Rio, selon Baudouin,
se d cha n contre toute suspension de la lutte . Boutillier ajoute
Thellier aux opposants. Mandel, quant lui, juge qu'il ne peut se taire plus
longtemps . Il s'oppose toute demande d'armistice en quelques phrases
sobres et coupantes . Il vitup re les jeunes ministres, Baudouin et
Bouthillier, entr s dans le cabinet pour faire la guerre et d sormais fervents
adeptes de la demande d'armistice. Que chacun se prononce nettement !
demande-t-il". La fissure apparue lors du deuxi me Conseil au ch teau de
Cang est d sormais cruciale. Mais, comme le croira Baudouin, la nettet n'est
pas ce que d sire le Conseil, profond ment divis . Restent les douze autres
ministres, ceux qui n ont rien dit. Pour chapper une logique d'affrontement
entre les deux groupes, plut t qu'une position tranch e, d'aucuns recherchent
une solution qui viterait la cassure du Conseil. Et dans la salle du Conseil
elle-m me, comme en 1936, comme en 1938, Chautemps ne restait pas inactif.
Et puis Chautemps parla
Sans doute le refus nergique de Weygand n a t il fait qu attiser
le d bat sans en modifier les donn es. Car c est avant qu il ne soit confirm
par le mar chal qui seul aurait pu obtenir le revirement, un troisi me clan
tait entr en action. Celui de ceux qui n avaient pas encore voulu ou su
prendre de position tranch e. Ils ont un chef de file Camille Chautemps.
Le d put de Blois avait entam sa description de la
situation militaire et humaine de la France de l'exode, que Mandel r sumait
ainsi : Inutile tuerie. Opinion publique. Intention g n reuse du vainqueur.
Mandel disait de lui : Il r p te le discours qu'il fera sur la tombe de la
France morte. Or ce discours servait d'introduction sa c l bre motion de
conciliation , destin e satisfaire partisans et adversaires de l'Armistice.
Selon Chautemps, le gouvernement pouvait ne pas s'opposer au transfert en
Afrique du Nord, mais il tait souhaitable que l'opinion publique compr t la
n cessit de cette mesure et n'accus t pas le gouvernement de d sertion. D s
lors n' tait-il pas plus raisonnable de demander aux Allemands les conditions
de l'armistice ? Ce n' tait aucunement capituler : en effet, comme les
exigences des Allemands allaient vraisemblablement tre inacceptables, cette
demande ne constituerait-elle pas la meilleure d monstration qu'il tait
n cessaire de continuer la lutte?
Les ministres pr sents virent-ils le pi ge dans lequel ils
allaient s enferrer ? La "proposition Chautemps" ne
permettait-elle pas de soutenir que l'on tait r solument contre l'armistice,
puisqu'elle avait pour objet de d montrer, au vu de la duret des conditions
pos es par les Allemands, la n cessit de continuer le combat ? Au-del de
l'habile pr sentation, demander les conditions d'un armistice paraissait
quivaloir une demande d'armistice effective, car, une fois dans l'engrenage,
il serait difficile, voire impossible, de reculer. Mandel percevait le
v ritable caract re de ce compromis insidieux, qui allait brouiller les
positions parce qu'il offrait un alibi inesp r aux h sitations des ministres
flottants . En un mot, il permettait d' luder a priori les engagements pris avec l'Angleterre, et pr sentait en
m me temps une habile chappatoire une situation d sesp r e. Pour tous, il
tait le moyen de gagner du temps . Frossard, appuyait la proposition, se
livrant sans vergogne des variations oratoires sur le th me armistice ne
veut pas dire capitulation . Pour Mandel, Chautemps tait plus que jamais le
man uvrier la souplesse f line dont le double jeu fut constant durant ces
tristes journ es , ainsi qu'il devait l'expliquer plus tard.
Tous les t moins ont attest qu'une majorit tait form e en
faveur de la proposition Chautemps, r unissant la fois les partisans
d termin s de l'armistice mais aussi les flottants , m me le pr sident de la R publique.
De m me que Weygand avait t le p ril de Tours, Chautemps se r v lait le
danger de Bordeaux. Albert Lebrun appuis la proposition Chautemps note
Baudouin tandis que le pr sident de la R publique t moignera que la proposition
a bien recueilli un cho favorable dans une partie du conseil . Pour
Bouthillier ce sont les trois quarts des ministres qui y taient favorables en
d autres termes 18 sur 24 tandis que seuls six taient contre (Mandel, Marin,
Dautry, Campinchi, Rio et Thellier, selon Bouthillier qui ne cite ni Monnet, ni
S rol). Pour Paul Reynaud, treize ministres sont pour, et six contre. Cette
majorit ne devait pas emporter pour autant la d cision. Paul Reynaud lui-m me
avait not sous les yeux d Albert Lebrun les noms des partisans et des
opposants la solution. La majorit existait bien mais elle ne se compta ni ce
jour l , ni le suivant. Il restait en ce quinze juin encore une arme Paul
Reynaud : la visite de l ambassadeur Campbell. La proposition Chautemps
est incompatible avec l engagement qui nous lie la Grande-Bretagne .
Offre t il sa d mission. Oui selon Baudouin et Lebrun. Mais Lebrun le retient.
D clare t il qu il va r fl chir ? Il d'attendre la r ponse de Roosevelt au
message de Reynaud du 14juin et demander aux Anglais l'autorisation d'ouvrir
des n gociations s par es.
Avait-il t question ce jour l de la flotte ? Nul ne
semble en avoir parl ? Paul Reynaud affirme avoir, la fin de ce premier
Conseil bordelais, demand au mar chal de reconna tre que livrer la flotte
serait contraire l honneur. Seul Herriot, qui, pr sident de la Chambre des
D put s n y assistait videmment pas, voque le m me fait dans ses Souvenirs.
Pas de d shonneur pour l arm e
Lorsque le Conseil se s para, 19 heures pour Bouthillier,
19 H 55 pour Weygand, plus de trois heures avaient pass . Weygand faisait
depuis plus de deux heures antichambre. Il assista la sortie un un des
ministres. Sauf Mandel et Bouthillier, rest s aupr s du Pr sident de la
R publique. C est l heure de sa deuxi me altercation de la journ e avec Paul
Reynaud. Les deux hommes auront de cette sc ne des versions diff rentes pour
les ann es venir. Paul Reynaud s est dirig vers lui la sortie du Conseil.
Cette fois il n envisage pas de le relever de son commandement mais entend lui
donner des ordres. Il demande une nouvelle fois la capitulation
hollandaise de l arm e. Selon Weygand, il aurait fait pr c der
cette demande de la mention : Ainsi que nous en avions convenu tout
l heure... provoquant l explosion du génél. Celui-ci dans un tat
de grande nervosit hurle, puis se met vocif rer, de plus en plus
fort : Il n y a pas une force au monde pour me faire signer la
capitulation d une arm e qui vient de se battre comme l arm e fran aise l a
fait . Reynaud l invite se calmer, mais le génél crie de plus en plus
fort : Jamais ne n infligerai pareille honte nos
drapeaux ! Et sans d semparer : Ah ! C est donc
pour cela que vous m avez fait revenir de Syrie ! . Weygand ne contestera
pas le ton, mais il lui donnera une autre cause que la nervosit : il lui
fallait tre s r d avoir des t moins de ses propos. Pour cela, le génél
choisit m me d entrer d un pas d cid dans la salle o venait se tenir le
Conseil pour tre entendu par le pr sident de la R publique. La
nervosit ne cesse pas au point qu Albert Lebrun n arrive pas lui
imposer le silence et se r fugie, en juriste prudent, derri re son
irresponsabilit constitutionnelle, pour refuser de l entendre hors la pr sence
du pr sident du Conseil. Paul Renaud d t revenir sur ses pas : Pas
de d shonneur pour l arm e . Le corollaire est d sormais clair, il
appartient aux politiques d assumer seuls le d sastre. Avec toutes ses
cons quences de droit et de fait. Le compte rebours gr ne ses ultimes
r missions.
Tout d pend
maintenant des Am ricains , devait dire Georges Mandel L on Blum. En
attendant, la r ponse de Roosevelt, puisque l arm e refuse de capituler, et
puisque la proposition Chautemps appara t une majorit comme un moindre
mal , Reynaud estime devoir au nom de la majorit du Conseil
demander Churchill le dernier viatique pour demander les conditions d un
armistice. Apr s 20 H, il convoque Campbell et Spears Rue Vital Carles. La
Rolls Royce de l ambassadeur pavois e de l Union Jack traverse nouveau
bri vement Bordeaux jusqu au Cours de l Intendance et franchit le barrage de
l entr e de la Rue Vital Carles. Selon le génél anglais, la rencontre
commence par un semi-incident. En guise d entr e en mati re, Reynaud aurait
adopt la version Baudouin : Comme M. Churchill a dit Tours qu il
accepterait que la France sollicite un Armistice... Paul Reynaud
n a-t il d cid ment pas de chances ce jour l avec ses entr es en
mati res ? Ou bien, ballott entre des partis radicalement oppos s,
n essaie t il plus d j que de faire accroire chacun ce qu il voudrait tant
pouvoir tenir pour vrai ? Aux premiers mots, les anglais se rebiffent
avant la fin de la phrase : Churchill n a aucunement dit cela. Spears qui
avait entrepris de prendre des notes pour r diger ses d p ches, pose son crayon
et dit :
- Je ne peux pas noter a, parce que ce n'est pas
vrai.
- Baudouin vient d'affirmer au Conseil qu'il l'avait
dit et que lui-m me l'avait not , ce moment-l , proteste Reynaud.
Curieusement les trois hommes taient tous les trois
pr sents la conf rence. Ils conviennent qu ils ne se sont pas absent s une minute
et que le Premier ministre n'a rien dit de tel. Campbell d clara, en outre,
que, le matin m me il avait demand Baudouin. d'o pouvaient provenir les
rumeurs qui couraient au sujet du pr tendu consentement donn par Churchill
une demande d'armistice par la France. Or, Baudouin lui aurait r pondu que
lui-m me savait parfaitement que le Premier ministre n'avait rien dit de tel,
ce qu'il tait pr t affirmer express ment.
Pendant la discussion assez confuse qui s'ensuit, quelqu'un
sugg re que Roland de Margerie soit invit montrer ses notes. Margerie
appara t d s que Reynaud a cess d'appuyer sur la sonnette et revient avec ses
notes de Tours, moins d'une minute apr s. Il les lit d'un bout l'autre,
debout, devant la table, en face du pr sident, la transcription des traductions
faites par lui et par Berkeley, Tours. Force tait de le constater :
elles ne contenaient pas un seul mot qui p t, d'une fa on quelconque, tre
interpr t de fa on justifier la d claration pr t e par Baudouin Churchill.
Paul Reynaud prend une feuille de papier et commence
r diger un message Churchill :
Au Conseil des ministres, cet
apr s-midi, il a t soutenu qu'au moment o l'ennemi est sur le point d'occuper
le pays tout entier, ce qui infligera des privations et des souffrances
cruelles la nation fran aise, le d part du Gouvernement serait consid r par
la population comme une d sertion. Cela pourrait entra ner de violentes
r actions de la part du public, moins qu'il ne soit tabli que les conditions
de paix impos es par Herr Hitler et le Signor Mussolini sont inacceptables
comme contraires aux int r ts vitaux et l'honneur de la France.
Le Conseil des
ministres ne doute pas que ces conditions soient en tous cas inacceptables mais
il a d cid que ce fait devait tre prouv , sans discussion possible. Si cette
proc dure n'est pas adopt e, ce sera la rupture du Gouvernement car, dans ce
cas, une grande partie de ses membres refusera de quitter le sol fran ais.
En vue de s'assurer
des conditions allemandes et italiennes, le Conseil a d cid de demander au
gouvernement britannique de s'enqu rir, par le truchement du gouvernement des
Etats-Unis, des conditions d'armistice qui seraient offertes la France, par
les gouvernements allemand et italien.
Le pr sident du
Conseil est autoris , si le gouvernement britannique est d'accord pour que le
gouvernement fran ais fasse cette d marche, d clarer au gouvernement
britannique que la remise de la Flotte fran aise l'Allemagne serait
consid r e comme une condition inacceptable.
Si le gouvernement
britannique refusait son consentement cette d marche, il semble, en vue des
opinions exprim es au Conseil des ministres, que le pr sident du Conseil
n'aurait d'autre alternative que de d missionner.
Alors qu il s appr tait achever la r daction, on apportait
Reynaud la r ponse de Roosevelt son ultime message , celui qui
avait t envoy le 14 au matin. En le lisant, il p lit encore, sa
figure se contracte, ses yeux deviennent des fentes peine perceptibles
dessinant un accent grave d'un c t
du nez et un accent aigu de
l'autre. crit Spears.
Confidentiel.
Washington, 15 juin, Il h du matin.
Je vous envoie
cette r ponse votre message d'hier, qui, je suis s r que vous vous en rendrez
compte, a t , de notre part, l'objet de l'examen le plus s rieux en m me temps
que le plus amical.
Permettez-moi,
d'abord, de vous r it rer l'expression de l'admiration toujours croissante avec
laquelle le peuple am ricain et son gouvernement rendent hommage au courage
clatant dont, sur le sol fran ais, font preuve les arm es fran aises dans leur
r sistance l'envahisseur.
Je tiens aussi
r p ter dans les termes les plus solennels que, ne n gligeant aucun effort
possible dans les conditions pr sentes, le gouvernement des Etats-Unis a permis
aux arm es alli es de se fournir dans ce pays, au cours de ces derni res
semaines, en avions, en artillerie et en munitions de toute nature et qu '
aussi longtemps que les gouvernements alli s poursuivront leur r sistance, il
redoublera lui-m me d'efforts dans ce sens. Je crois possible de dire qu'avec
chaque semaine qui passe, une masse de plus en plus importante de mat riel de
guerre sera mise en route destination des nations alli es.
Conform ment sa
politique de non-reconnaissance des acquisitions territoriales r alis es par la
force des armes, le gouvernement des Etats-Unis se refusera reconna tre la
validit de toute tentative de nature porter atteinte l'ind pendance de la
France et son int grit territoriale.
Dans ces heures si
d chirantes pour le peuple fran ais et pour vous-m me, je vous assure de ma
plus extr me sympathie et je puis vous assurer, en outre, qu'aussi longtemps
que le peuple fran ais continuera d fendre sa libert et, par l -m me, la
cause des institutions d mocratiques dans le monde, il pourra compter recevoir
des Etats-Unis, en quantit s toujours croissantes, du mat riel et des
fournitures de toute nature.
Je sais que vous
comprendrez que ces d clarations ne sauraient impliquer aucun engagement
d'ordre militaire. Le Congr s est seul avoir le pouvoir de prendre de tels
engagements.
Le coup n'est pas moins dur pour avoir t attendu. Selon
Spears Reynaud le supporte pourtant bien. . Il l ve les yeux sur ses
deux interlocuteurs britanniques et leur dit d une petite voix sans
timbre : Notre appel a chou , les Am ricains ne d clareront pas
la guerre. Puis il se remet crire.
Le paragraphe suivant de son t l gramme M. Churchill se
r f rait Tours :
"Il a t entendu, l , jeudi dernier, sur votre
suggestion, que la question d'autorisation d'une demande d'armistice serait
reconsid r e si la r ponse du pr sident Roosevelt tait n gative. Cette
ventualit s' tant produite, je crois que la question peut tre nouveau
pos e
Il remet le message en leur demandant de le transmettre avec
la plus grande c l rit et d'insister sur le fait qu'il est l'expression d'une
d cision officielle du Conseil des ministres r uni sous la pr sidence du
pr sident de la R publique. Il demande une r ponse pour le lendemain matin,
dimanche.
Apr s avoir quitt Reynaud, l ambassadeur Campbell et le major
génél Spears se sont rendus la pr fecture pour avoir la tendance exacte du
Conseil avant de transmettre leurs d p ches. Mandel donnait non seulement sa
version des faits : Faute d'une direction nergique, le Conseil avait d vi
vers la solution Chautemps mais il l accompagnait ses informations d une
exhortation tant qu'il en tait encore temps. Il demanda Campbell et Spears
d inciter le gouvernement britannique rappeler au gouvernement fran ais que
ni la Pologne, ni la Norv ge, ni la Hollande n'avaient renonc se battre dans
des circonstances similaires et qu'on ne saurait accepter moins de
d termination de la part de la France. Une fois encore, il adjura de ne pas
d lier la France de ses engagements du 28 mars, car autoriser une demande
d'armistice, c'est rendre in vitable une abjecte capitulation . Pour lui, la
France tait li e par l'engagement sacr
de ne pas conclure de paix s par e . Si le gouvernement britannique refusait
de lib rer la France de ses obligations, les ministres flottants qui d j
taient pr ts s'abandonner la solution Chautemps pourraient tre amen s
un tat d esprit plus viril et plus r aliste . A 1H 20 depuis le Consulat
d Angleterre, Campbell faisait transmettre le message de Reynaud Londres.
Auparavant vers minuit il a pu t l phoner directement Londres pour pr ciser
que la question pos e par Reynaud avait pris en ce quinze juin une forme
brutale depuis la r ponse des Etats Unis. La r ponse manant de lord
Halifax ne tarda gu re. Elle tait pr cise :
L ambassadeur devait s opposer aussi fortement que possible
la demande fran aise
Aucune d cision ne saurait tre prise par la France avant
une nouvelle rencontre avec la Grande Bretagne. L Angleterre y croyait elle
encore ? Les instructions pr cisaient qu en cas d chec l ambassadeur
devait inviter instamment les Fran ais suivre l exemple de la Hollande et
quitter la France avec lui .
Ce m me soir, Mandel n a pas re u que Campbell et Spears.
Apr s le d ner, il a re u la visite du s nateur Tony-R villon. Comme Jules
Moch le matin m me, il fait part de ses pointages: quatorze ministres contre
l'armistice, dix pour. Mais les h sitants gagnent. Mandel n'a pas confiance en
Lebrun, ind cis : Les partisans de l'armistice font une forte pression sur
lui. Au nombre de ceux qui resteront fid les leur point de vue jusqu'au
bout , il cite Renaud, Campinchi, Marin, Rio, Julien, Rollin, Dautry... Faire
la chasse aux flottants , telle est son obsession. Il est d sormais trop
tard pour ceux que Jeanneney appelle les d faitistes syst matiques comme
Pomaret , mais il reste ventuellement agir sur ceux que le m me
Jeanneney qualifiera de veules types Frossard et surtout sur ceux qui
bien orient s, c dent toujours, genre Pernot . Tony-R villon, Mandel
r p te ce soir-l ce qu'il avait dit de Gaulle deux jours plus t t :
L'incapacit de nos chefs militaires nous a fait perdre la bataille de France,
mais notre pays n'est pas d finitivement vaincu [... ]. Demain, nous pouvons
aussi vaincre en M diterran e. Je crois la sup riorit des forces des
d mocraties. C'est folie de se d clarer vaincus lorsque nous pouvons tre
vainqueurs en continuant la lutte avec nos alli s dans notre empire africain.
Pour l'heure, il fallait tenir le front des politiques. Allez voir les
ministres ! Nos adversaires ne sont pas inactifs , exhorta Mandel.
Ce soir l , Paul
Reynaud d commandera son d ner avec les pr sidents des deux Chambres pr vu pour
22 heures. Et il n y aura pas comme la veille de pic-nic Rue Vital Carles. Paul
Reynaud que Spears d crit "bl me, frip , il avait l aspect d un linge
empes qui serait tomb dans une baignoire , ira d ner au Restaurant du
Splendid, sur la place des Quinconces avec Devaux mais aussi avec deux
partisans d cha n s de l armistice, le colonel de Villelume, et Madame de
Portes. Plus que jamais l approche de l heure d cisive, Madame de Portes qui
dirigeait nergiquement la circulation des v hicules officiels en pantalon
rouge, dans les ch teaux de Touraine, croit pouvoir mieux que personne
concilier les deux exigences qui sont les siennes : demander l armistice
et garder le pouvoir. Paul Reynaud lui sait d sormais que l un exclut l autre,
sauf y tre express ment autoris par Churchill. Mais Madame de Portes a trouv
une solution qui r duit toute difficult : un gouvernement P tain avec
Paul Reynaud pour vice Pr sident du Conseil qui apporterait ainsi au mar chal
dans la coulisse l appui de son exp rience . Le programme est tellement
irr aliste que Paul Reynaud sourit de la contradiction qu il rec le. Mais
Madame de Portes devant deux t moins c de la violence verbale et cherche les
mots qui blessent : Vous n tes pas fran ais lui lance t elle.
Elle s offre lui prouver qu il est l che. A plusieurs reprises elle le d fie.
Le pr sident du Conseil finit par lui lancer deux verres d eau la figure.
C est ce qu a retenu Villlelume en cette nuit de drame.
A la m me heure,
Anatole de Monzie et Jean Mistler sont dans le bureau de l ambassadeur
d Espagne qui a lui aussi repli son ambassade au consulat de Bordeaux. Ils y
resteront jusqu apr s minuit. Que pr parent-ils Bordeaux en cette soir e du
15 juin, eux qui ne sont pas ministres ? Nous essayons de pr voir la
proc dure et les modalit s de l armistice expliquera Monzie. L ambassadeur
a sur sa table la liste des visas demand s dans la journ e pour le transit en
Espagne. Nous parcourons avec lui cette liste qui porte en premi re ligne un
nom de diplomate fran ais. Les noms juifs viennent ensuite commente-t-il
avant de se livrer diverses plaisanteries en imaginant le pr sident Jeanneney
en colonel des zouaves pontificaux. C est une vue assez drolatique dans
la d solation de cette nuit d attente tragique . Le gouvernement Paul
Reynaud n a plus qu un jour vivre. C'est, en effet, dans la journ e du 16juin
que le sort du minist re Reynaud devait se jouer.
[ ]
Bordeaux Juin 40 au jour le jour
Par Bertrand FAVREAU
I LE CHOIX DE BORDEAUX
3
16 juin : se battre ou ne pas se battre
1. 14 juin : L installation
2. 15 juin : Armistice ou Capitulation
3. 16 juin : se battre ou ne pas se
battre
La Crise du 16 juin.
Le 16 juin 11 heures, se r unissait, rue Vital-Carles, le deuxi me
Conseil des ministres de Bordeaux. La r ponse de Roosevelt, pleine de
commis ration et d'attentisme, tait arriv e. Pour Mandel, il s'agissait d'un
message d cisif : L'Am rique, sans
fard, laissait pr voir son intervention militaire future. Pour le moment [ ]
elle pr cisait son concours [ ] lointain mais certain. Il fallait tenir
jusqu' son arriv e. H las, lorsque Reynaud en fit part au Conseil, sa
lecture jeta le d sarroi [...]
Comme s'il tait possible, cet instant de l'Histoire, d'obtenir autre chose
de M. Roosevelt , dira Mandel.
Dans ce climat de consternation, le mar chal P tain se leva
de nouveau et lut, debout, une lettre de d mission qu'il avait tir e de sa
poche. Motif: le retard demander l'armistice. Mais la r ponse de Churchill
n' tait pas parvenue, et l'insistance de Lebrun et de Reynaud parvint faire
admettre au mar chal qu'il convenait d'attendre la r ponse de l'alli
britannique la demande pr sent e par le Conseil.
Une nouvelle r union tait pr vue pour l'apr s-midi. 13 h
30 arriva la r ponse anglaise en deux t l grammes successifs. C' tait une
acceptation conditionnelle: la France pouvait demander les conditions de
l'armistice, sous r serve d'envoyer au pr alable sa flotte dans les ports
anglais. Pourtant, les ministres n'auraient pas se prononcer sur les
exigences britanniques, que Reynaud lui-m me n'acceptait pas. Car, peu avant le
Conseil des ministres, les t l grammes du Foreign Office furent suspendus
et l'ambassadeur Campbell alla m me jusqu' pr ciser qu'ils taient annul s
. L'Angleterre avait mieux proposer. De fait, le génél de Gaulle t l phona
une nouvelle proposition du gouvernement anglais: l'union franco-britannique.
Sur une id e de jean Monnet et de sir Robert Vansittart, secr taire génél du
Foreign Office, la solution avanc e voulait ne faire plus qu'une seule et m me
nation des deux pays, unis pour le meilleur et pour le pire. Winston Churchill,
au d but r serv sur le projet, devait confirmer lui-m me par t l phone Paul
Reynaud son approbation de cette union indissoluble entre la France et
l'Angleterre.
Pass le premier moment d'euphorie, il apparut que le coup
de th tre de l'apr s-midi du 16 juin ne faisait aucun effet sur le Conseil,
accabl par l'ampleur du d sastre et prostr face aux malheurs de la France. Le
d bat sur l'union franco-britannique allait tourner court: P tain d clarait que
c' tait une fusion avec un cadavre (Weygand ne r p tait-il pas qui
voulait l'entendre qu' avant trois semaines l'Angleterre aurait le coup tordu
comme un poulet ?). Chautemps et Ybarn garay opposaient que la France
allait devenir un dominion , ce quoi Mandel r torqua: Pr f rez-vous tre
un district allemand ? Phrases peut- tre apocryphes ou vraisemblablement
prononc es en dehors de la s ance du Conseil, dont la simple relation a posteriori t moigne du climat -
exacerbation des positions et confusion - dans lequel la proposition anglaise,
que Reynaud lut deux fois au Conseil, fut - sans d bat - cart e. Et, d s lors,
ce fut dans une atmosph re de plus en plus tendue qu'on donna au Conseil
lecture du texte d'un t l gramme du génél Georges: Situation encore
aggrav e... n cessit absolue prendre d cision.
Or, la d cision tait presque acquise la veille. Et son
concepteur, Chautemps, revint la charge. Il reprit sa proposition, bien
d cid r ussir l o Weygand avait chou . Mandel savait que le temps tait
venu d'arr ter Chautemps. Car ce dernier tait bien le seul, d sormais,
pouvoir obtenir du Conseil qu'il se r solve demander un armistice dont la
majorit de ses membres ne voulaient pas tout en croyant qu'effectivement il ne
le demandait pas. J'esp rais par une intervention violente forcer mes
coll gues envisager les r alit s de la situation , dira-t-il. Mandel n'eut,
d s lors, qu'une r ponse la proposition de Chautemps: La question est
simple. Il y en a, ici, qui veulent se battre, et d'autres qui ne le veulent
pas. Non, r pliqua Chautemps, qui plus tard minimisera l'incident, il y a
des Fran ais galement conscients de la grande d tresse o ces revers
militaires ont plac la France, et d sireux de trouver les moyens les plus
ad quats. Et il aurait ajout : je n'ai pas de le on recevoir de M. Mandel.
L'incident - violent , selon Pomaret - cristallise les opinions ,
remarque Lebrun. Et Paul Reynaud de noter que le d saccord tourne la
querelle " . La discussion reprit. Pour Mandel, la France ne pouvait se
r signer la capitulation la plus humiliante de son histoire dans l' quivoque
et les faux-semblants, sans que chacun ait pris solennellement ses
responsabilit s devant l'Histoire. Pour en finir, il demanda que l'on Proc de
au vote. En vain. La tradition est qu'on ne vote pas au Conseil des ministres.
Reynaud se contenta de proposer une nouvelle r union du Conseil pour le soir
22 h.
A-t-il annonc que le gouvernement tait d missionnaire?
Mandel, pas plus que Marin ou Campinchi, ne l'a entendu. Harass , il revint
la pr fecture o l'attendaient Georges Wormser et Andr Diethelm, ses deux
anciens chefs de cabinet. Livide... puis , il devait dire: Nous sommes
battus, la l chet l'emporte. J'ai fait ce que j'ai pu. Il y aura un troisi me
Conseil des ministres dans la soir e mais n'en esp rez rien. Il appela
Jeanneney et Herriot, avec lesquels il n'avait cess de se concerter. Il vit
L on Blum, qui affirmait avoir pris en main S rol et garantissait son
revirement en faveur de la poursuite de la lutte pour 22 h. Il re ut les
nombreuses personnes qui se pressaient sa porte, fit un nouveau pointage avec
Louis Marin et Campinchi. Pourtant, il sembla d sabus ses proches. Sans
doute restait-il un dernier et secret espoir: convaincre Lebrun, comme Mandel
l'avait annonc Georges Monnet, de ne pas choisir le nouveau pr sident du
Conseil parmi les partisans de l'armistice. C'est l'ultime message que Mandel
tenta alors de transmettre Spears et Campbell avant qu'ils ne se rendissent
aupr s du pr sident du S nat: refuser la d mission de Reynaud pour le charger
de faire un nouveau gouvernement de r sistance. Lui ou Mandel, tel sera le
message port par l'ambassadeur anglais Jeanneney, l'homme qui, selon Mandel,
avait le plus d'influence sur le pr sident de la R publique. Or, Jeanneney
professait que demander ne serait-ce que les conditions de l'armistice serait
couper le jarret au pays" . Mais, les v nements allaient plus vite que
les subtilit s du r gime parlementaire. Lebrun avait d j nomm P tain, qui lui
avait instantan ment remis -, heureuse surprise selon le pr sident de la
R publique - la liste de son gouvernement. Dans son gouvernement figuraient les
onze membres du cabinet Reynaud acquis la demande d'armistice. Le nouveau
gouvernement n' tait plus divis , mais son homog n it n' tait pas dans le sens
esp r par Mandel: les mous avaient chass les durs , les d faitistes
avaient vinc les partisans de la r sistance.
Les pointages du 16 juin
Le d compte des partisans ou des opposants l'armistice a
donn lieu, pendant trente ans, des pol miques (en 1943, avec Pomaret et
Pertinax, en 1969 avec encore Pomaret). Mandel, quant lui, fid le sa
sp cialit , n'avait pas manqu d'op rer de savants pointages, pris sous sa
dict e par Jules Moch, Tony-R villon et Louis Marin. jules Moch, il ne cita
le 15 juin que huit ministres partisans certains de l'armistice , peut- tre
neuf, contre neuf acquis la capitulation . Tout au long des ann es
d'apr s-guerre, il a t d montr , pour des raisons diverses, dont la moindre
n' tait peut- tre pas d'ailleurs la r alit du fait, qu'il y avait, le 16 juin
1940, une majorit contre l'armistice et que Paul Renaud avait, de ce fait,
abandonn la partie contre la majorit de son Conseil. Louis Marin, qui
d tenait un pointage de Mandel du 16juin, s'est plus particuli rement occup de
v rifier ce d compte dans le cadre de la commission d'enqu te parlementaire.
Pourtant, une telle d monstration a
contralio est de peu de ressource pour l'analyse des faits. D'une part,
parce que, apr s 1945, tous les acteurs de ces v nements qui n'avaient pas
ouvertement pris position avaient int r t soutenir qu'ils avaient t oppos s
l'armistice. Et, d'autre part, parce que le rapprochement des divers
t moignages connus suffit apporter un commencement d'explication pertinent
pour l'appr hension de ces journ es troubles.
En tout tat de cause, et malgr la demande de Mandel, le
vote pour ou contre l'armistice n'a pas eu lieu. Le dernier pointage de Mandel
ne devaitjamais recevoir la v rification du suffrage. Il n'est plus temps de le
d plorer. Deux l ments, toutefois, viennent att nuer r trospectivement la
port e historique de cette absence de scrutin. Le premier est que, partir de
tous les t moignages connus, l'on peut d terminer avec une quasi-certitude ceux
qui, sans doute possible, taient contre l'armistice : Mandel, Reynaud, Monnet,
Rio, Marin, Dautry, Laurent-Eynac, Campinchi, julien et Rollin, auxquels il
faut ajouter Delbos, et ce en d pit des doutes s rement injustes (selon Spears,
notamment, qui r sidait avec lui l'h tel Montr ) de Mandel ou de la m moire
d faillante de jules Moch, soit onze voix. Avec la m me certitude on sait qui
tait pour : P tain, Chautemps, Ybarn garay, Prouvost, Bouthillier, Pomaret et
Frossard, auxquels on peut ajouter Rivi re et Chich ry, soit neuf voix (si l'on
admet que Baudouin, sous-secr taire d' tat, partisan de l'armistice, n'ait pas
t appel voter bien qu'il se soit exprim au Conseil, et dix voix dans le
cas contraire). Quant aux autres, c'est l'incertitude. Certes, ult rieurement,
Rio a bien class Queuille et Thellier parmi les adversaires de l'armistice,
mais il se r f rait un article de Gringoire paru sous l'occupation.
Questionn s avec insistance par Louis Marin, devant la commission d'enqu te,
Louis Rollin s'est content de r pondre par oui ou par non, et Laurent-Eynac
par pour ou contre l'appel des noms des ministres et ce sous la
r serve expresse des d faillances de m moire . Et, comme devait le dire
Georges Monnet en 1948 de ceux qui ne se sont manifest s ni dans un sens ni
dans l'autre : Rien ne permet de dire qu'ils n'auraient pas soutenu
Reynaud". Or, il y avait vingt-quatre membres appel s voter au Conseil
des ministres et aucune certitude n'a pu tre donn e quant aux quatre autres:
Queuille g n , selon Rollin, par l'attitude de Chautemps, S rol, oscillant, de
l'aveu m me de Blum, Pernot et Thellier, sur lesquels les avis les plus
contradictoires ont circul et sur la position desquels averses conjectures
restent possibles.
Par ailleurs, comme Mandel l'a bien compris d s le d but,
sans doute parce qu'il en redoutait les effets, la d mission de Paul Reynaud ne
s'est aucunement fond e sur une majorit ou une minorit quant l'armistice.
C'est le ralliement - admis par tous les t moins - de la majorit du Conseil
la proposition Chautemps , qu'il appellera plus tard l' op ration Chautemps
- au grand dam de Pomaret -, qui a fait opter Paul Reynaud pour la position
de d missionnaire, car il ne voulait en aucune circonstance r pudier l'engagement
qu'il avait sign avec les alli s britanniqueS46. Sur cette analyse, du
moins, Reynaud a le soutien de Mandel, qui devait expliquer plus tard L on
Blum, au cours de leur d tention commune, comment la proposition Chautemps
>, ou la suggestion Chautemps-Frossard avaient fait l'effet d'une
plaque tournante sur laquelle avait pivot la majorit du cabinet
Reynaud. Et l'ambigu t demeure, car il n'y avait, la lettre, aucune
contradiction entre une position hostile l'armistice et une adh sion la
proposition Chautemps, qui avait pour finalit de d montrer que les conditions
d'un armistice pr sent es par l'ennemi taient inacceptables, ce qui rendait
indispensable la poursuite de la lutte.
Paul Reynaud, lui-m me, n'a gu re aid la clarification.
Sur le papier griffonn l'instant des d clarations - qu'il ne devait
retrouver que bien tardivement -, il avait consign parmi les ministres
favorables la proposition Chautemps , outre les fervents de l'armistice,
les noms de Queuille, Thellier,julien, Laurent-Eynac, pourtant consid r s par
certains t moins comme des adversaires de l'armistice. Sur la liste o taient
cens s figurer ceux qui taient contre, on ne trouve toutefois que les noms de
Rio, Marin, Delbos, Georges Monnet, Rollin mais aussi S rol (souvent pr sent
comme plut t enclin l'armistice). D'une fa on plus surprenante encore ne
figurent parmi les contre ni le nom de Mandel, ni celui de Campinchi, ni le
nom de Dautry, en lesquels tout le monde s'accorde voir les fers de lance de
la poursuite du combat. Paul Reynaud pouvait-il ignorer leur soutien, alors
qu'il devait crire dans ses M moires
qu'au lendemain de sa d mission il avait re u la visite des ministres qui lui
taient rest s fid les et qu'il cite nomm ment : Mandel, Marin, Campinchi,
Rio, Dautr-y, Monnet, Rollin, Delbos, mais aussi Laurent-Eynac (pourtant
partisan suppos de la proposition Chautemps), alors qu'il omet, cette fois-ci,
S rol, qui en aurait t l'adversaire? Paul Reynaud a-til pu douter un seul
instant de la position de Mandel ?
Mandel et Reynaud
Sans doute Paul Reynaud devait-il r valuer la baisse le
r le de Mandel - alors disparu - dans ses diff rents crits post rieurs la Lib ration.
voquant le deuxi me Conseil du 16juin Bordeaux, il crit: Mandel, qui
parle pour la premi re fois au Conseil sur la question de l'armistice... En
janvier 1964, il dira de m me Henri Amouroux: Mandel s'est tu. Pourquoi ?
Je n'en sais rien". Or, une telle affirmation est en contradiction
radicale avec les indications donn es par les autres t moins : Lebrun, qui a
parl de sa passion g n reuse au cours du d bat , mais aussi Baudouin,
Bouthillier, Pomaret ou Laurent-Eynac. Il est vrai que Mandel avait moins que
tout autre marquer une position, que tout le monde connaissait, par des
d clarations fracassantes; mais, plus encore, la plupart des acteurs hostiles
sa th se - et m me Chautemps - lui ont donn acte d'une d termination constante
lors des r unions du Conseil des ministres. Les d clarations r trospectives de
Paul Reynaud, alors que Mandel disparu ne peut r pondre, ne sont-elles pas un
aveu de faiblesse? Et, au-del d'une volont d'autojustification fond e sur
l'abandon dont il aurait t la victime, l'expression de l' volution des
relations entre les deux hommes? Car les trois mois du minist re Reynaud sont
aussi l'histoire de la d gradation progressive des rapports entre Mandel et
Reynaud.
J'avais toujours t , au cours de ma vie politique, en
parfaite communion d'id es avec Georges Mandel, que ce f t en 1935, lorsque
Mussolini avait abattu la s curit collective, lorsque le 7 mars 1936 la
Wehrmacht envahit la Rh nanie, lorsque, en septembre 1938, ce fut Munich [...
]. C'est la raison pour laquelle je lui demandai d' tre mon collaborateur le
plus direct , rappela Paul Reynaud en voquant les d buts de son
minist re". La carri re des deux hommes, tous deux lus pour la premi re
fois en 1919, puis battus en 1924, n'a jamais manqu de points de rencontre. Le
pass , toutefois, n'avait gu re marqu de convergences. Mandel tait r serv
sur l'op ration de la Ruhr tandis que Reynaud en exaltait les m rites la
tribune. quinze jours d'intervalle, en 1925, dans La Revue hebdomadaire, Reynaud avait c l br les m rites du pacte
de Locarno alors que Mandel en condamnait les inexorables dangers. Mais, d s le
d but des ann es trente, le pass poincaro-briandiste de Reynaud oubli , les
deux hommes s' taient rapproch s au point que leur noms fussent
indissolublement li s partir de 1936: Mandel et Reynaud . Cette
association fut-elle sans ombre aux heures de p ril? En mars 1940, l'identit
de vues entre les deux hommes ne fait pas de doute. On sait que Mandel apporta
m me des rectifications au discours d'investiture de Reynaud et lui fit
rajouter la mention de la trahison russe , pour faire taire la pr vention de
pro-sovi tisme encore pr sente dans l'esprit de certains d put S51. Pour
leurs adversaires, sans aucun doute, ils formaient une quipe . Et plus
encore, au sein de cette quipe, Mandel tait la t te pensante dont Paul
Reynaud tait l'orateur" . Cette croyance tait largement admise par
certains de ceux qui partageaient leurs id es: Mais comment Mandel ne lui a
pas conseill ? s'indignera Paul-Boncour au moment de regretter que les
parlementaires n'aient pas t consult s en juin 1940. Mandel, conseil de
Reynaud? Il ne fait pas de doute que l'un a t aupr s de l'autre l' me de la
r sistance et le garant du jusqu'au-boutisme . Churchill lui-m me se
r jouissait moins de voir Reynaud au pouvoir que de savoir Mandel ses
c t s . Mais cette influence n'a cess de reculer. Cang , Paul Reynaud se
retrouva dans la situation de Daladier, avec un conseil divis entre durs
et mous , d faitistes et bellicistes . D j , l'influence de Mandel
tait toutefois s rieusement contrebalanc e par l'entourage imm diat de Paul
Reynaud: Baudouin, qui restait un conseiller cout au moins jusqu' Tours, le
colonel de Villelume, r solument hostile Mandel et qui a reconnu plus tard
avoir t acquis la capitulation d s le 25 mai. Il y avait aussi la comtesse
H l ne de Portes, g rie de Paul Reynaud et v h mente propagandiste en faveur
de l'armistice, ensorceleuse pour lie Bois, inqui tante personne pour
Jules Jeanneney. De fait, son labeur incessant n'aura t que de soustraire
Paul Reynaud l'influence de celui qu'elle appelait ce cochon de Mandel .
Bordeaux, o la lutte fut sans merci, elle avait m me t , selon
Benoist-M chin, jusqu' chercher des hommes de main pour faire abattre celui
qu'elle consid rait comme le seul responsable de l'obstination de Reynaud
refuser l'armistice. Moins excessif, Mandel n'avait pas h sit , quant lui,
charger un commissaire de police, Marc Berg , d'interdire l'acc s des salles de
r union Mme de Portes. Efforts qui devaient rester vains. Toute la nuit est
elle pour d faire ce qu'a fait le 53 ministre de l'Int rieur , a dit
Pertinax en des termes vocateurs
Mandel lui-m me semblait progressivement d u par l'attitude
de Reynaud. Sa r solution lui semblait tenir plus de l'intelligence que du
caract re . Lors du premier Conseil des ministres du gouvernement Reynaud, il
avait gliss l'oreille d'Anatole de Monzie: M. Paul Reynaud a le pouvoir.
Il ne lui manque plus que de le m riter". En fait, d s le d but mai il
le trouve fatigu . Reynaud, il est vrai, ne l' coutait plus. Mandel avait
tent de s'opposer la mise l' cart d'Alexis L ger: Si vous le renvoyez,
on interpr tera cela comme le premier mouvement de retour vers la politique que
vous avez jusqu'ici combattue , avait-il pr venu. Mais il semble que Mme de
Portes ait eu le dernier mot. Le 5 juin, au soir, selon les notes de Rio,
Mandel n' tait pas au courant du remaniement qui justifiait la convocation du
Conseil des ministres pour d mission collective". Spears il confie le 13
juin: Il est tr s influen able (il faut entendre par Mme de Portes et non
plus par lui, Mandel). Le 15juin, il exhorte Reynaud : Puisque vous ne voulez
pas capituler, manifestez VOUS ! Le
soir, il se plaint d'une absence de direction nergique du Conseil des
ministres et il dit l'ambassadeur de Pologne: Reynaud se trompe. Le
peuple fran ais peut encore tre r veill . Le 16 il d clare: Reynaud n'a
plus aucune autorit . , Savoir si Paul Reynaud tiendra bon , telle est sa
hantise ce jour-l ". Manifestement, la ligne directe qui le reliait Paul
Reynaud ne fonctionnait plus. Mandel est avec Louis Marin et Campinchi,
champions de la poursuite de la lutte, de ceux qui crurent qu'il y aurait une
r union du Conseil le 16juin 22 h et qui quitt rent L on Blum pour s'y rendre
en lan ant: Cette fois, on va en finir... On va voter6o. Mais, comme les
autres, il apprit en arrivant qu'il n' tait plus qu'un ministre
d missionnaire . Le soir m me, il s'abstint de prononcer le nom de Reynaud
devant ses amis r unis la pr fecture. Pourtant, devant le génél Spears, il
retrouva envers Reynaud les cruels propos qu'il appliquait, jadis, Briand et
Poincar : Reynaud avait lu deux fois la proposition britannique au Conseil
des ministres, mais sans flamme, sans conviction, comme un avocat qui lit un
document . Et de commenter, selon Spears: Quand les troupes sont saisies de
panique, il n'y a qu'en tirant dessus qu'on peut les arr ter. La seule chose
que Reynaud ait tir c'est son verrou pour pouvoir d camper".
Si, par la suite, la solidarit d'une d tention commune n'a
pu que les unir au moment de l' preuve, Jules Moch a affirm cependant avoir
t le t moin, au d but de 1941, dans la voiture de police qui les convoyait de
Pellevoisin Vals-les-Bains, d'un r quisitoire violent de Mandel contre
Reynaud:
"Vous ne vivez pas dans le r el. Votre
imagination vous cr e un monde dans lequel vous vous enfermez et auquel vous
cherchez appliquer les rem des convenant, selon vous, la maladie dont vous
l'avez affubl ..."
Et de poursuivre:
"Vous n'avez jamais tenu bon, quand vous
tiez chef du gouvernement en 1939. Vous n'avez pas os vous replier en Afrique
du Nord quand cela tait possible, alors que c' tait la seule solution
permettant de sauver l'honneur et de poursuivre la guerre. Le choix de vos
ministres tait souvent d testable: P tain, Paul Baudouin, etc. Vous avez
remplac le génél Gamelin - notoirement insuffisant - par Weygand qui ne
l' tait pas moins. Vous avez conserv Weygand apr s que je vous eus prouv
qu'il vous avait menti propos de la prise du pouvoir par les communistes
Paris, afin d'obtenir l'armistice. Mis en minorit par vos ministres
d faitistes, vous les avez suivis au lieu de les r voquer et de reconstituer un
cabinet d cid sauver l'honneur "...
Paul Reynaud, un instant muet, puis affichant un sourire
indiff rent, commenta simplement: Vous tes dur, mon cher! Jusqu' 1940,
c' tait Paul Reynaud qui passait pour un dur . En 1937, il avait publi un
opuscule sur le probl me militaire fran ais, soulignant la n cessit de la
fermet face au r armement allemand. En exergue, il avait tenu inscrire la
phrase que venait de prononcer le mar chal von Blomberg, ministre de la guerre
du Reich: Malheur aux faibles!
Quant Mandel, ministre parmi les ministres, qui n' tait qu'un
second, que pouvait-il faire de plus? Peut- tre a-t-il secr tement, tout en
s'en d fendant, caress une autre esp rance au moment o il vit Reynaud
vaciller? Si Reynaud jetait l' ponge, il lui faudrait un successeur. L'ancienne
proph tie de sa jeunesse l'a-t-elle une fois encore taraud en juin 1940?
Georges Monnet, Mandel avait non seulement d clar , peu apr s l'arriv e du
gouvernement Bordeaux, qu'il y avait lieu de ne conserver dans un cabinet
que ceux qui veulent continuer la guerre , mais il avait ajout : Si Reynaud
veut d missionner, Lebrun ne peut confier le nouveau gouvernement qu' Reynaud
ou une autre personnalit r solue continuer la guerre. Or, ses amis comme
ses adversaires les plus acharn s ont rendu Mandel cet hommage unanime: il a
t le chantre le plus d termin de la continuation du combat. Aussi peut-il
avoir t effleur par l'esp rance diffuse que l'esprit de r sistance allait
souffler et que son heure allait venir? Guerre ou capitulation? Telle tait
l'alternative. l'option armistice s'opposait l'option guerre outrance
. L'issue tait bien entre la demande d'armistice avec P tain et la poursuite
de la guerre soit avec Reynaud, nerveusement hors d' tat de diriger le
gouvernement, soit avec une autre personnalit r solue continuer la guerre
, avait dit Mandel Georges Monnet. Donc, plus s rement, avec lui, Mandel,
dont la volont n'avait jamais faibli. Une autre solution avec Mandel ,
envisageait le génél Spears. Baudouin lui-m me ne s'y est pas tromp ,
lorsqu'il crut pouvoir plus tard d montrer que Reynaud, en proie la
lassitude , avait admis lui-m me qu'il fallait arr ter le combat devenu
inutile : La preuve? [... 1 il ne recommande pas la formation d'un
minist re Mandel. Depuis de nombreux mois on disait : Mandel serait
peut- tre un bon chef, mais juif, impossible , notait Jeanneney dans son
journal.
Parce que je suis juif
Reynaud avait jet
l' ponge, mais tout n' tait pas jou . Au soir m me de ce triste 16juin, dans cette
pr fecture qu'il allait quitter avec ses fonctions de ministre, Mandel
recevait, pour la derni re fois, la visite du génél Spears. l'heure o un
nouveau gouvernement allait demander l'armistice, le major anglais cherchait un
Fran ais pour l'amener en Grande-Bretagne continuer la guerre. Il lui fallait
quelqu'un dont le nom tait connu et dont l'opinion aurait du poids... Il
venait de consulter Reynaud,, r fugi dans l' vasion , qui avait refus . Or,
celui que Spears voulait emmener, c' tait Georges Mandel, l'homme politique
fran ais qu'il pr f rait. Il avoua l'avoir suppli , de s'envoler le
lendemain matin avec lui. Il faut une voix fran aise autoris e, qui n'ait
jamais accept la capitulation, pour assurer la direction de l'Empire fran ais.
L'Empire fran ais, l'ancien ministre des Colonies plus que tout autre y
pensait r solument. Une flotte invaincue! Une arm e coloniale de qui on
pouvait tout attendre dans les batailles africaines 15 1 Mais au soir de ce
dimanche 16 juin, partir, n' tait-ce pas fuir? Choisir l'Angleterre? N' tait-ce
pas abandonner la France? Comme Spears insistait, Mandel lui exposa: Vous tes
inquiet pour moi parce que je suis juif. Eh bien, c'est justement parce que je
suis juif que je ne partirai pas demain [... ]. On croirait que je me sauve,
que je c de la panique. Mercredi, peut- tre. Et tandis que Spears lui
objectait: Ce sera peut- tre trop tard! , Mandel r p ta simplement: je ne
partirai pas demain.
La veille, il avait tenu le m me discours lors de la visite
du ministre des Affaires trang res polonais Zaleski, qui l'appelait
l'indomptable Mandel,, et l'exhortait prendre les leviers de commande: Il
ne faut pas oublier que je suis juif ". Ainsi Mandel qui, toute sa vie,
avait entendu des sarcasmes relatifs sa religion, propos de laquelle L'Action fran aise, je suis partout, Gringoire s' taient d cha n s depuis des mois, ne
voulait pas que l'on puisse dire que le juif Mandel avait d sert . Ou que
celui qui ses ennemis avaient refus sa qualit de fran ais l gitime avait
eu pour premier r flexe de rejoindre l' tranger. Telle e t t l'in luctable
cons quence d'un d part solitaire pour l'Angleterre alors que l'armistice
n' tait pas sign . N'avait-il pas choisi, d j , une autre voie, en obtenant le
transfert du gouvernement Bordeaux? R sister dans l'Empire qu'il s' tait
acharn pr parer pour la guerre, sur ces terres fran aises qu'il appelait
dans ses articles de jeunesse ces prolongements de la m re patrie ? Dans la
lumi re vacillante des bougies, Spears vit alors la porte du cabinet de Mandel
s'entrouvrir. Un visage clair et long se profila dans l'obscurit . C' tait
B atrice Bretty, qui affirmera plus tard qu'elle voulait que Mandel suive son
destin. Sans intervenir dans la conversation, parce qu'elle savait sans doute
de quoi il retournait, elle commenta simplement mais de fa on ferme: Les malles sont pr tes, Georges !
Les malles n'avaient t pr par es que pour traverser la rue Esprit-des-Lois.
Il s'agissait d sormais de lib rer l'appartement minist riel improvis de la
pr fecture et de prendre r sidence l'h tel Royal-Gascogne. Il restait au
génél Spears prendre cong de Mandel qui tait pour lui de loin l'homme
le plus courageux qu'il y eut Bordeaux .
bient t, tr s bient t Londres, j'esp re .
Le lendemain matin, Spears repartirait pour Londres sans
Georges Mandel. Il ne serait pas seul. La veille, au sortir du bureau de Paul
Reynaud, il avait trouv un militaire fran ais qui demandait partir Londres
pour continuer le combat: il s'appelait le génél de Gaulle. Mandel avait-il
manqu l'occasion de repr senter aux yeux du monde ce qu'il apparaissait tre
indubitablement dans le regard des Fran ais : le premier r sistant ?
[ ]
Bordeaux Juin 40 au jour le jour
Par Bertrand FAVREAU
II-
LA CAPITULATION DE BORDEAUX
4. 17 juin :
Cesser le combat ,
4.
Cesser le combat ,
Les pr misses du 17 juin.
La nuit du 16 au 17 juin 1940
avait t d cisive: Weygand et Darlan ordonn rent le d part de la flotte vers
l'Afrique du Nord. Peu apr s minuit, Paul Baudouin, nouveau ministre des
Affaires trang res du gouvernement P tain, avait t charg de demander
l'Allemagne et l'Italie, par l'interm diaire de l'ambassadeur d'Espagne, les
conditions de cessation des hostilit s. Vers une heure du matin, Pomaret,
nouveau ministre de l'int rieur, se rendait la pr fecture pour la passation
des pouvoirs . Mandel, affable , l'y accueillit avec la courtoisie d'usage:
je quitte regret le gouvernement. La politique dans laquelle on s'engage n'a
pas mon approbation, vous le savez, et je la combats. Au moment o il
franchissait les quelques m tres qui le s paraient de l'h tel Royal-Gascogne,
o il avait ses habitudes et o il allait tablir d sormais son quartier
génél, Mandel ne d sesp rait pas. Certes, il avait connu des moments
d'extr me fatigue et sans doute avait-il, lui aussi, particip
l'accablement, la stupeur généle que produisait la d faite et qu'aggravait
l'exode-" . Pour lui, comme il l'avait dit Pomaret, le combat ne
cesserait pas. Lui qui, plus que tout autre, se rem morait toujours les
d sastres de la Grande Guerre ne pouvait s' tre r sign la d faite. Il croyait
en un dernier sursaut. Jamais il n'a d sesp r de la France, alors puis e,
saign e, d moralis e. Pourtant, en cette nuit du 16 au 17 juin, ce n' tait pas
un nouveau chef de gouvernement qui en rempla ait un autre: la Ill R publique
agonisait tandis qu'un nouveau r gime naissait. Et de ce changement, Mandel
allait tre une des premi res victimes.
Le 17 au matin, Baudouin
remettait de m me au nonce apostolique, Val rio Val ri, une note demandant au
Saint-Si ge de porter aussi rapidement que possible la connaissance du
gouvernement italien la note remise l ambassade d Espagne l intention du
gouvernement allemand. Il ajoutait qu il esp rait galement pouvoir
faire part aujourd hui au gouvernement italien de son d sir de
rechercher avec lui les bases d une paix durable entre les deux pays . A
neuf heures le matin dans son repaire de Br ly de Pesche, Hitler a t avis .
Ainsi, apr s les Pays-Bas, apr s la Belgique, la France s croulait. Il fut
pris d un rire nerveux et se tapa la cuisse avec la main comme pour
dire : et de trois ! . Les services diplomatiques avaient
bien transmis non seulement une demande d armistice mais une demande des
conditions de paix. Ce n est qu en fin de matin e onze heures quarante,
que l ambassadeur d Espagne faisait savoir que la transmission avait t
effectu e. Il ajoutait que le colonel Begebder tait tr s mu , et avait
pri monsieur de Lequerica de transmettre ses salutations tr s affectueuses au
mar chal P tain .Pendant ce temps, les troupes allemandes continuaient
leur avance en direction de l oc an, de Belfort et de la Suisse. Une
autre communication serait transmise . Aucune indication sur la
suspension des op rations militaires.
Les partisans de
l'armistice savaient que Mandel n' tait pas hors de combat du seul fait de la
chute du gouvernement Reynaud. Mandel tait celui que l'on craignait. Non
seulement il tait l'adversaire d clar de l'armistice, mais il tait seul
capable d'agir. Le dimanche 16 juin, dans la soir e, le gouvernement P tain
tait peine form qu'ordre avait t donn de faire garder toutes les issues
de la pr fecture de la Gironde par un d tachement de gardes mobiles. Pour
entrer l'ultime r union des adversaires de l'armistice avant le Conseil des
ministres (qui n'aurait pas lieu), apr s 20 h, Louis Rollin, arrivant de la
chambre de commerce voisine, o r sidait le ministre des Colonies, avait t
oblig de forcer un v ritable barrage: On ne peut pas entrer la pr fecture
voir Mandel? Qu'est-ce qu'il y a? Avait-il protest . D s leur d part, la
pr fecture s' tait referm e, cern e par un cordon de troupes command es par un
colonel en grande tenue. Somm de s'expliquer et de se retirer, l'officier
d clara simplement: J'ai ordre de veiller sur votre s curit '. Au matin du
17 juin, Mandel d m nageait en compagnie de sa fille Claude, de B atrice Bretty
et de son fid le valet, Baba. Il fit transporter ses tr s nombreux bagages ,
dont une malle noire ficel e comme un saucisson qui ne pesait pas moins de
cent cinquante kilos qui refera parler d'elle, dans la chambre 206 de l'h tel
Royal-Gascogne, baptis e chambre royale . C'est l qu'il entendait mobiliser
toutes les nergies pour continuer la lutte. Au cours de la matin e, la chambre
d'h tel prenait l'aspect d'un cabinet minist riel dont le portier de l'h tel
serait devenu l'huissier, . l'heure o le mar chal P tain, la radio,
invitait les troupes cesser le combat , en ce 17 juin, Mandel le visage
maci , le front encore plus p le que d'habitude prenait son premier repas
d'homme d charg de toute fonction gouvernementale, dans son restaurant
pr f r , Le Chapon fin. Les tables y
taient prises d'assaut par le Gotha de la politique et de la diplomatie
r fugi Bordeaux. La Troisi me R publique mourait, serviette au menton ,
commentera Louise Weiss, qui, comme le comte Sforza, y d jeunait ce jour l . Au
moment du dessert, les privil gi s qui avaient t accept s une table eurent
la surprise de voir le colonel commandant la gendarmerie de Bordeaux
s'approcher de la table de Georges Mandel et lui enjoindre de le suivre. Il
tait porteur d'un ordre d'arrestation visant Mandel, mais galement le génél
B hrer. Motif: Men e contraire l'ordre public. l'officier le pressant,
Mandel lan a avec l'autorit du ministre qu'il tait la veille encore: Vous
me laisserez finir mes cerises. Et, devant tous les assistants qui purent
admirer sa ma trise et son calme, il finit son cognac, se leva, baisa la main
de B atrice Bretty et suivit l'officier. Comme B atrice Bretty se levait pour
le suivre, le ma tre d'h tel s'inqui ta: Qui paiera? Et Louise Weiss lui
r pondit d'une boutade double sens: Le mar chal!
Le génél Lafont prit sur
lui de ne pas crouer Mandel et B hrer, arr t quant lui au milieu de son
tat-major des colonies la chambre de commerce, au fort du H , comme l'avait
demand Rapha l Alibert. Ils furent consign s dans les bureaux de la
gendarmerie, ruej juda que, s par ment, l'un dans le bureau du colonel, l'autre
dans celui du commandant, avec des injonctions strictes: Attention, pas de
signes pour l'ext rieur. Dans la ville surpeupl e et bruissant de toutes les
rumeurs, la nouvelle de l'interpellation publique s' tait r pandue comme une
tra n e de poudre. L'arrestation d'un parlementaire, au m pris de son immunit ,
dans le chef-lieu du d partement dont il tait le d put parut aussi
inqui tante qu'invraisemblable. Bobard! c'est s r , commenta Jeanneney
". Pourtant, la r alit du fait fut bien vite attest e par les proches et
les membres du cabinet de Mandel, parmi lesquels Philippe Roques, que
Tony-R villon rencontra boulevers et qui alerta les pr sidents des
Assembl es. Inform par Jeanneney, Herriot, qui n'avait pas trop r agi ,
selon le pr sident du S nat, se mit en campagne, mais vainement" .
Finalement, c'est chez le pr sident de la R publique, que d sole
manifestement l'incident , que se rendirent les pr sidents des deux Chambres.
Lebrun avait d j convoqu Alibert pour explication. Et ce dernier avait risqu
une justification: l' tat de si ge . Ce quoi Jeanneney r torqua: Seul un
flagrant d lit pourrait lever l'immunit parlementaire Il ne peut tre de
manger des cerises, m me au Chapon fin".
Pendant que se prolongeait
cet entretien des trois pr sidents, Pomaret, qui avait t pr venu de
l'arrestation et qui avait annonc sa d mission dans l'heure si son
pr d cesseur n' tait pas rel ch , se rendit chez le mar chal P tain, en
compagnie de Frossard, ministre des Travaux publics. leur arriv e, Alibert,
que le pr sident de la R publique venait d'inviter approfondir l'enqu te sur
les faits reproch s aux deux infortun s avant de le cong dier, tait pr sent.
Le motif avou de l'arrestation fut enfin donn : Mandel avait t d nonc par
une lettre anonyme adress e au bureau local des services de renseignements pour
avoir fait rassembler des armes en vue d'attenter la vie des membres du
gouvernement et d' emp cher l'armistice . Mais il y avait aussi une raison
inavou e: la haine de Rapha l Alibert, sous-secr taire d' tat la pr sidence
du Conseil, doctrinaire antis mite d'extr me droite. La d nonciation manait,
en fait, d'un journaliste de Je suis
partout, d nomm Georges Roux, propagateur d'une rumeur qui n'avait m me
pas t v rifi e". Quant aux armes, c' taient les fusils du corps de garde
du minist re des Colonies qui avaient t transport s de Paris Bordeaux et
qui taient confi s la garde d'Indochinois " . Ce qui avait justifi la
mise en cause de B hrer. Vers 18 h, sur la demande de Pomaret et de Frossard,
le génél Lafont fit compar2Citre les deux suspects dans le bureau du
Mar chal. B hrer tait en larmes , Mandel, imperturbable, refusa la main que
lui tendait Pomaret, dont il ignorait alors le r le exact. tonn de ce geste,
le Mar chal, d signant Pomaret et Frossard, risqua: Vous avez ici deux amis!
je le crois, Monsieur le Mar chal luda, grin ant, Mandel. Puis, comme
P tain affectait de demander des explications, Mandel le coupa, de sa voix
s che: je ne m'abaisserai pas vous donner des explications. C'est vous de
m'en fournir. C'est une affaire qui commence. Nous la r glerons plus tard.
Aujourd'hui, je vous dis simplement ceci: je vous plains, Monsieur le Mar chal,
d' tre la merci de votre entourage et je plains mon pays qui vous a pris pour
chef . Comme le Mar chal n'avait pas ou feignait de ne pas avoir entendu,
Mandel r p ta alors plus fort et en d tachant les syllabes: je dis bien, Monsieur le Mar chal, je vous
plains, je veux dire: j'ai de la commis ration pour vous. Dans la
discussion qui devait suivre, P tain c da du terrain: les renseignements
avaient peut- tre t recueillis avec l g ret . Il parla de malentendu .
Il va sans dire que je n' tais pas dupe, commentera Mandel. je ne songeais
cependant pas lui reprocher personnellement un acte qui lui avait sans doute
t inspir par son entourage, je me bornais lui demander de m'exprimer ses
excuses par crit".
L' change avait montr
l'autorit naturelle qui se d gageait alors de Mandel. Et, la surprise de
Pomaret et de Frossard, le Mar chal s'ex cuta et passa dans le cabinet
d'Alibert pour crire la lettre demand e.' Lorsque le texte lui en fut remis,
Mandel estima qu'il n' tait aucunement la hauteur de l'outrage commis et ne
le prot geait pas de poursuites ult rieures. Il refusa la lettre: je ne vous
ai pas fourni d'explications [... ]. C'est vous qui m'en deviez et qui m'en
avez donn . Le Mar chal dut refaire son billet. Mandel lui dicta lui-m me les
termes qu'il d sirait voir figurer dans cette lettre d'excuse .
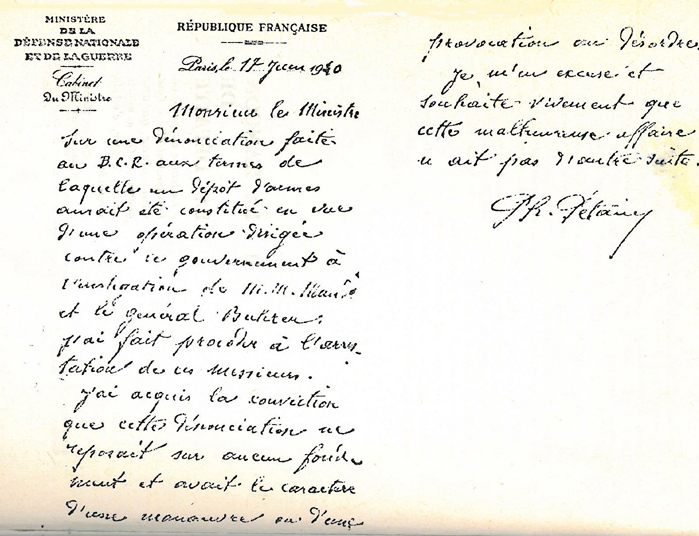
Monsieur
le Ministre,
Sur une
d nonciation faite au B.C.R. aux termes de laquelle un d p t d'armes aurait t
constitu en vue d'une op ration dirig e contre le gouvernement l'instigation
de MM. Mandel et du génél B hrer, j'ai fait proc der l'arrestation de ces
Messieurs.
J'ai
acquis la conviction que cette d nonciation ne reposait sur aucun fondement et
avait le caract re d'une man uvre ou d'une provocation au d sordre. Je m'en
excuse et souhaite vivement que cette malheureuse affaire n'ait pas de suite.
Ph. P TAIN.
sept heures du soir,
cinq heures apr s le d but de l'incident, Pomaret d posa Mandel (et B hrer) au
Royal-Gascogne. L'arrestation de Georges Mandel, premier acte public du nouveau
gouvernement P tain, tait l' v nement du jour. Cet incident montre, parmi
d'autres, l' tat d' nervement dans lequel on vivait , devait commenter
placidement Lebrun. Mauvais d but de la
l galit nouvelle , assura de fa on plus p n trante Monzie ".
P tain avait crit qu'il
s'excusait et d clar que l'affaire n'aurait pas de suites. Mais Mandel
craignait qu'elle n'en e t. peine raccompagn son h tel par Charles
Pomaret, il s'enquit, en compagnie de son fid le collaborateur Max Brusset, de
faire photographier la lettre du Mar chal. Il redoutait alors qu'elle ne lui
f t reprise par la force. D sormais, la lettre ne le quitta plus. Il l'exhibait
au soir de son infortune, en racontant lui-m me la sc ne qu'il avait v cue, et
il la portait encore sur lui le jour de sa mort. Car l'affaire allait avoir
bien des suites. Pomaret, bien plac , n'a-t-il pas mis l'hypoth se de ce que
le d nonciateur n'aurait t que le colporteur d'une information pr par e,
organis e la pr sidence du Conseil, chez Alibert ? De fait, Alibert
d testait Mandel, qu'il n'appelait que le juif , et, selon la relation faite
par Mandel Reynaud, P tain aurait, devant lui, tanc Alibert: C'est vous
qui m'avez fait faire cela. Alibert ne devait d'ailleurs pas en rester l .
Devenu ministre de la justice du gouvernement de P tain, il fut l'instigateur
de la loi du 30 octobre 1940, cr ant un statut des juifs en France : la
loi Alibert . Pour l'entourage de Mandel, toutefois, et notamment pour Max
Brusset, l'arrestation avait pour origine une autre ranc ur plus tenace que
celle d'Alibert: la haine du génél Weygand 17. En tout tat de cause, Monzie
l'ajustement not : Mandel a bien t la premi re victime de la l galit
nouvelle .
L'incident, appel une
grande fortune historiographique, n' tait pas neutre. Ni par les proc d s ni en
raison de la victime. Le nouveau gouvernement avait bien compris, d s l'instant
de sa mise en place, que Mandel personnifiait puissamment la r sistance
l'armistice . Et qu'il tait bien d termin ce que la lutte se poursuiv t.
Car, si les partisans de l'armistice taient bien au pouvoir, la France n'avait
pas d pos les armes. Le 17 juin au soir
arriv rent du front des nouvelles d sastreuses. Celles qui provenaient des routes
de l'exode taient pires encore. Et il n'y avait alors aucune r ponse la
demande des conditions d'armistice.
[ ]
Bordeaux Juin 40 au jour le jour
Par Bertrand FAVREAU
II- LA
CAPITULATION DE BORDEAUX
4. 17 juin : Cesser le combat ,
5. 19-20 juin :
Partir ou ne pas partir
6. L honneur ou la honte
[ ]
5.
19-20 juin : Partir ou ne pas partir
La demande des conditions d armistice n avait rien r gl . La
capitulation de l arm e pouvait sous-entendre la continuation de la lutte, qui rendait
n cessaire un d part au-del de la m tropole. Au contraire, les partisans les
plus acharn s de l'armistice taient ceux qui ne voulaient pas quitter le sol
fran ais. D s le 18 juin, chacun allait pouvoir entrevoir clairement que
l quation n tait pas si simple.
Le 18 juin, l avance des arm es allemandes est plus
importante encore. Les Allemands s installaient sur les rives de la Loire. Ils
avaient encercl Moulins et marchaient sur Vichy et Roanne apr s avoir occup
Le Creusot. Belfort tait prise et les divisions motoris es avaient d pass
M con avant de foncer sur Lyon. Les plus fervents partisans de l armistice
s avis rent que la progression de la Wehrmacht tait tellement fulgurante qu il
tait d sormais redouter que le gouvernement de la France ne f t fait
prisonnier. Voici que le d bat partir ou ne pas partir rebondit en attendant le
bon vouloir du F hrer.
Pris leur
propre logique, les d fenseurs de la solution Chautemps devaient admettre de
l autre c t que, rester sur place, port e de mains des arm es allemandes,
sans conna tre les conditions allemandes d armistice, que l on s est
th oriquement r serv de refuser si elles taient contraires aux lois
de l honneur tait une attitude injustifiable, de la part de ceux-l
m mes qui en avaient fait leur cheval de bataille. [ ]
Partir
Le 18 juin, l'avance des arm es allemandes posa nouveau la
question du transfert des pouvoirs publics. La progression de la Wehrmacht
tait tellement fulgurante qu'il tait redouter que le gouvernement de la
France ne f t fait prisonnier. Situation que les partisans de l'armistice,
suivant leur propre logique, pouvaient difficilement accepter, tant il tait
vident qu'un gouvernement captif de l'ennemi ne pourrait mener utilement des
n gociations. De m me, il convenait de r server l'hypoth se selon laquelle les
conditions allemandes d'armistice seraient jug es contraires aux lois de
l'honneur , donc inacceptables, par ceux-l m mes qui les avaient sollicit es.
Mardi 18 juin. Les durs se r unissent chez Herriot dix
heures trente. Les ministres durs hier, ne sont redevenus que de
simples d put s. Ils ne d tiennent plus la moindre parcelle d autorit
publique. Le quartier génél des durs ne pouvait pas se tenir dans la simple
chambre de Mandel au Royal-Gascogne, d sign e tous les regards. Leur
"quartier génél" s'installe donc au 41, cours Xavier-Arnozan, le
pav des Chartrons bordelais , o Herriot habitait. Dans cet h tel particulier
se retrouvent d sormais r guli rement, le plus souvent deux fois par jour,
Jeanneney, le pr sident du S nat, mais aussi Mandel, Marin, Blum, Campinchi,
Monnet, Delbos, Bastide, Thellier. Mais la question :
partir ? il y avait un corollaire : le choix a t entre le
sol fran ais, qui se peut r sumer utilement alors l Afrique du Nord, ou la
terre des alli s, l Angleterre. Et, le d bat tait encore plus pernicieux. Car
il y avait ceux, qui taient pr ts accepter l armistice quelles que soient
ses conditions, et ceux-l ne voulaient partir aucun prix. Plus encore, il
leur fallait tout prix emp cher les d tenteurs d une parcelle d autorit
morale, de partir, peine de risquer de cr er inexorablement une autorit
concurrente. Le d bat va occuper trois jours de vie bordelaise : du 18 au
21 juin.. Le message tr s ferme de Roosevelt est parvenu le matin m me :
si la France livre la flotte, c est la fin de l amiti et de la bonne volont
am ricaine.
Jeanneney et Herriot se d cident alors crire au Pr sident
de la R publique,
Monsieur le Pr sident de la R publique,
Nous avons eu hier la grande satisfaction d entendre
Monsieur le Mar chal P tain et Monsieur le Ministre Baudouin d clarer qu ils ne
sauraient -et nous en tions bien s rs- accepter que des propositions
respectant les lois de l honneur.
En des heures o les v nements voluent si vite et, par
leur rapidit , risquent de nous d passer, nous tenons vous confirmer temps,
ce que nous avons dit hier encore savoir qu aucune consid ration ne nous
permettrait d admettre comme conciliable avec l honneur de la France une paix
s par e qui d chirerait nos engagements avec la Grande-Bretagne et la Pologne,
compromettrait de fa on grave nos relations avec les Etats-Unis, ruinerait
notre consid ration dans le monde et sp cialement pr s des peuples qui ont li
leur sort au notre et qui, en fait par la livraison ou m me par la disparition
de la flotte, renforcerait les moyens d attaque de nos ennemis contre nos
alli s.
Nous ne saurions douter que le gouvernement interpr tera
ainsi que nous-m mes ses propres d clarations lorsqu il recevra les r ponses
qu il attend.
Veuillez agr er, Monsieur le Pr sident de la R publique,
l hommage de notre respectueux d vouement.
Sign :
Herriot, Jeanneney.
A la m me heure, le 18 juin, le Conseil des Ministres s est r uni
rue Vital Carles. Le génél Weygand, nouveau ministre de la guerre, expose en
d tail une situation militaire toujours tr s alarmante (selon
Lebrun). Baudouin a lui aussi re u par Biddle, le message comminatoire de
Roosevelt. Le Conseil s attache donc s auto-exhorter la fermet . Il d finit
ainsi ce qui sera pour lui le sens de l honneur. Il d cide que la flotte ne
doit pas tre laiss e la disposition de l Allemagne. La question du d part
est abord e. Elle ne re oit aucune r ponse. Pourtant l avance sur Bordeaux est
une r alit m me si les rumeurs les plus alarmistes qui circulent dans la ville
surchauff e (les Allemands encerclent Bordeaux) est fausse. A quinze heures, ce
m me 18 juin, il y a une r union au S nat que Jeanneney appelle le Capitole.
Cin ma. S nat , il n y est question que de l avance allemande sur
Bordeaux.
M me th me de r union seize heures, cours Xavier-Arnozan,
en pr sence des pr sidents des chambres et des d put s habituels qu ont rejoint
Chautemps et Reynaud. C est l ins curit Bordeaux qui pr vaut. Chautemps
lui-m me r alise t il que le pi ge qu il a labor risque de se refermer sur
lui ? Et il entrevoit que la France n est d j plus en mesure de donner un
libre consentement des clauses qu elle ne conna t pas encore. L effervescence
est son comble et Baudouin lui-m me a not dans son ph m ride la
forte agitation chez les parlementaires en cet apr s-midi du 18 juin.
La question
n est plus faut-il ? Mais o ?
[ ]
Aucune
nouvelle de la demande d armistice notait Baudouin au terme de son
compte-rendu de la journ e du 18. Ce n est que deux jours apr s, le mardi 18
minuit trente que l ambassadeur d Espagne informa Baudouin de ce qu Hitler
prenait son temps. Le F hrer avait d j pris le train pour Munich o il devait
rencontrer Mussolini et r gler avec lui les armistices avec la France.
La mission Dudley Pound
-Alexander- Lloyd,
Le gouvernement anglais n' tait pas rest inactif.
Le 17 juin, l'ambassadeur Campbell avait repr sent au nouveau gouvernement de
la France les deux d p ches du 16 juin, autorisant la demande d'armistice sous
conditions, et qui avaient t retir es la veille. Le m me jour, Churchill
avait cru devoir adresser l' illustre mar chal P tain et au fameux
génél Weygand l'ultime adjuration de ne pas livrer l'ennemi la belle
flotte fran aise,> afin que leurs noms ne soient pas marqu s au fer rouge
pendant mille ans d'histoire .
Le 18 juin, le génél de Gaulle s' tait vu offrir
les antennes de la B.B.C. pour lancer son c l bre appel. Ainsi le Royaume-Uni
menait-il d'un c t des actions h sitantes et parfois contradictoires , pr t
qu'il tait encourager l'esprit de r sistance, au risque de contrarier le
gouvernement de Bordeaux , sans perdre pour autant tout espoir, d'un autre
c t , de voir le nouveau gouvernement fran ais lui-m me gagner l'Afrique du
Nord et continuer la guerre". Un d part du gouvernement fran ais vers
l'Afrique du Nord, accompagn d'une vacuation massive des troupes sous la
double protection des flottes fran aise et anglaise, tait tudi . En m me
temps, l'id e d'inviter des personnalit s politiques fran aises repr sentatives
constituer un gouvernement de r sistance n' tait pas abandonn e. C'est cette
multiplicit d'efforts, quelque peu confuse, qui poussa Churchill envoyer
deux missions s par es Bordeaux les 19 et 20 juin.
La premi re, men e par Jean Monnet, emportait Ren
Pleven, Robert Marjolin, Emmanuel M nick, les trois mousquetaires , vers
Bordeaux dans un hydravion, le Claire, mis leur disposition par Churchill. Sa
capacit (trente personnes) et son rayon d'action avaient t choisis
dessein. L'objectif tait clair: transporter ces grands d fenseurs de la
libert , qu taient Lebrun, Reynaud, Herriot, Jeanneney, Blum, Mandel, d positaires
de la plus grande part de souverainet 20 . Parvenue Bordeaux, la mission
des mousquetaires rencontrera Baudouin, Herriot, Blum. Ren Pleven, quant
lui, tait plus particuli rement charg de convaincre Georges Mandel . Plus
tard, il racontera jean Lacouture que s'il avait chou , c' tait parce qu'il
tait un provincial peu au fait des secrets de la vie parisienne .
Mandel, pour refuser ses sollicitations, lui aurait r pondu. Monsieur, j'ai
de trop gros bagages pour vous accompagner. Pleven n'insista pas . Et
lorsqu'elle retourne Biscarosse pour remonter bord du Claire et voler vers
Londres, la mission Monnet-Pleven a bien compris une chose : le gouvernement ne
partira pas.
La seconde mission fut men e en parall le
par l'amiral sir Dudley Pound, le premier lord de l'Amiraut Alexander, et lord
Lloyd, ministre des Colonies, qui s'attard rent Bordeaux jusqu' la
fermeture des derni res portes . Sa t che officielle, selon Churchill, tait
de prendre tous les contacts possibles avec les nouveaux ministres . Depuis,
John Colville, chef de cabinet de Churchill, a d voil dans ses M moires le
vrai but de Lloyd: convaincre Georges Mandel de gagner l'Angleterre avec lui,
dans son propre avion, pour y former avec de Gaulle l'embryon d'un gouvernement
en exil . Voil ce qu' tait, crira Colville, la grande id e du jour" .
Ramener Mandel Londres, l'exp dition Lloyd fut bien pr s d'y r ussir. Car
Herriot allait d signer un envoy outre-manche: Je n'entends sous aucun pr texte que vous tombiez entre les mains des
Allemands, avait-il dit Mandel. Je
vous ficellerai plut t et vous ferai emmener, vous avez t trop violemment
attaqu par tous les Ferdonnet d'outre-Rhin pour leur donner la satisfaction de
tomber entre leurs mains. Et, sur papier en-t te du pr sident de la
Chambre des d put s, il lui donna un ordre de mission officiel, dat Bordeaux
du 20 juin: je prie l'autorit anglaise d'accueillir bord du bateau que lord
Lloyd a bien voulu faire venir ma demande, M. Georges Mandel, ancien ministre
de l'Int rieur.je serai reconnaissant des gards qu'on voudra bien lui
t moignera. Selon le r cit indirect et tr s incertain de lord Lloyd lord
Halifax, Mandel aurait bien demand l' missaire britannique s'il pouvait
repartir en Angleterre en lui pr cisant qu'il avait aussi des bagages , ce
que Lloyd d clarait avoir traduit en bon anglais comme d signant sa ma tresse
et qui l'aurait conduit tirer un trait , ou, comme Pleven, ne pas
insister . Comme la premi re, cette seconde mission rentra en solitaire.
Il faut que j'aille l -bas!
Car, au sein du gouvernement m me, il semblait en
effet que la th se de l'Afrique du Nord semblait l'avoir emport . Mandel, en relation
constante avec Herriot et Jeanneney, les avait pouss s se rendre aupr s
d'Albert Lebrun pour le supplier de sauvegarder l'ind pendance du gouvernement.
Lebrun s' tait laiss persuader. Le mar chal P tain lui-m me, qui ne cessait,
depuis le 12 juin, de psalmodier Moi je ne m'en irai jamais de France >,,
avait fini, semblait-il, par se rallier l'id e d'un d part. S'il refusait de
quitter lui-m me la France, il admettait l'id e d'une scission de l'ex cutif.
Camille Chautemps, le vice-pr sident du Conseil, le repr senterait en Afrique
du Nord avec une d l gation de signature. Spears, Mandel avait dit:
Mercredi, je ne dis pas. D j , le mercredi 19 juin, la solution anglaise
paraissait d finitivement d pass e et, le jeudi 20, la voie officielle de
l'Afrique du Nord tait ouverte. D s lors la cause tait entendue. Aurais-je
pu le convaincre? s'interrogeait Ren Pleven, plus de quarante ans apr s les
faits, devant Jean Lacouture, exprimant comme une ultime amertume de son chec.
Pleven, en effet, ne jugeait r trospectivement son insucc s qu' l'aune de
l'histoire crite depuis les v nements. Le 20 juin midi, la d cision de
Georges Mandel tait prise: [... ] la condition de la r sistance c' tait le
d part des pouvoirs publics de la m tropole [... ].je resterai l o se
tiendront les pouvoirs publics condition qu'ils ne soient pas plac s sous la
protection de l'ennemi". Mandel avait d cid de voyager sous pavillon
fran ais . Il devait dire Louis Marin, comme si, lui, Mandel, le petit-fils
du ciseleur bavarois, n'avait pas d'autre choix: je n'ai pas plus confiance
que vous dans le gouvernement mais il faut que j'aille l -bas .
Le jour m me de la visite de lord Lloyd, le 19 juin,
Herriot avait re u une lettre de Darlan lui annon ant que le paquebot Massilia tait mis la disposition des
parlementaires pour les emmener en Alg rie. Le comit du 41, cours
Xavier-Arnozan, qui si geait presque en permanence, d cida de se r unir une
nouvelle fois 21 h. Le d part semblait tellement imminent que Mandel comme
tous les participants, de Louis Marin L on Blum, taient venus en voiture
avec leurs chargements de bagages. Mais la d cision se faisait attendre, non
sans susciter l' irritation croissante de Mandel".
Dans la nuit du 19 au 20, peu apr s minuit, Bordeaux
tait pour la premi re fois bombard . Les participants du cours Xavier-Arnozan,
durent poursuivre leur r union sous l'escalier de pierre et dans les pi ces
avoisinantes. Ce premier contact du gouvernement avec les r alit s de la guerre
avan a la d cision.
20 juin, 9 H
heures conseil des ministres.
Le 20 juin, onze heures, nouvelle r union avec
voitures et bagages chez Herriot. C'est pendant celle-ci que Pomaret informa le
pr sident de la Chambre que le Conseil des ministres venait de d cider le
transfert du gouvernement Perpignan. Il embarquerait ensuite Port-Vendres
pour l'Afrique du Nord. Les parlementaires, eux, voyageraient sur le Massilia. Peu apr s, un avis, sign
Darlan, fut affich , au milieu de la journ e, dans les locaux de la Chambre (
l' cole Anatole-France) et du S nat (au cin ma Capitole, rue juda que):
Le gouvernement,
d'accord avec les pr sidents des Chambres, a d cid hier 19 juin que les
parlementaires embarqueraient sur le Massilia aujourd'hui 20.
La rivi re ayant
t min e Pauillac, le Massilia n'a pas pu remonter Bordeaux comme pr vu et
est rest au Verdon.
C'est donc au
Verdon que doivent se rendre les parlementaires, par des voitures que le
gouvernement devra leur procurer [... 1.
Sign :
F. DARLAN.

Ordre d'embarquement de
Jean Zay sur le Massilia,
r dig par le ministre de
l'Int rieur,
Charles Pomaret.
Ils ne seront que tr s peu lire ce message et
seulement 27, dont un s nateur, s'embarquer. Ce qu'ils ignoraient, cependant, c'est que si la d cision avait bien t prise,
un pre combat se livrait autour de P tain et de Lebrun. Laval, Marquet mais
aussi Alibert, Bergery et Pi tri faisaient le si ge des deux pr sidents. Apr s
une r union l'Ath n e, les parlementaires hostiles cette ventualit
composent une d l gation conduite par Pierre Laval et comprenant, notamment, A.
Marquet, G. Bonnet, Pi tri et. Portmann qui rencontre le pr sident Lebrun,
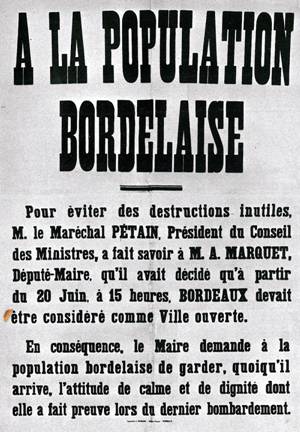
20 juin 15 heures. Bordeaux
Ville ouverte.
Le 20 juin, 14 h, coup de
th tre: alors que Blum, Jeanneney, Georges Monnet, Julien et S rol, forts des
indications donn es par Pomaret, roulaient d j vers Perpignan via Toulouse et
que Lebrun s'appr tait les suivre, un conseil de cabinet tait inopin ment
suscit par Weygand. Le pr sident de la R publique tait pri d'attendre...
Parce que la d l gation d'armistice venait de partir pour rencontrer les
Allemands Tours 19 h. L'acc l ration des pourparlers d'armistice ne faisait
que renforcer la d termination des adversaires du d part. Alibert, quant lui,
bien d termin ne pas laisser le pr sident de la R publique emporter
outre-mer une part de la souverainet nationale, ne recula pas devant le
mensonge ni n'h sita produire un faux, qu'il revendiquera par la suite.
Mensonge: il affirma que les Allemands n'avaient pu passer la Loire, contenus
qu'ils taient par les troupes fran aises. Faux: il apposa le cachet du
Mar chal sur un ordre qu'il adressa aux ministres aux termes duquel ceux-ci
devaient demeurer leurs domiciles dans l'attente de nouvelles instructions.
De ce sursis au d part Herriot a pu tre pr venu. Blum, Jeanneney ont t
rattrap s sur leur itin raire Toulouse et ont rebrouss chemin dans
l'apr s-midi du 20 juin.
Entre temps, les premiers
passagers s' taient achemin s au Verdon pour embarquer. Ils n'avaient re u
aucun contrordre. 20 h enfin, apr s une longue attente, les passagers, sans
recevoir de contrordre, mont rent dans des chaloupes pour rejoindre le Massilia amarr au milieu de la rade du
Verdon. bord, vingt-sept parlementaires qui partaient rejoindre en Afrique du
Nord un gouvernement qui allait rester Bordeaux : outre Georges Mandel,
vingt-cinq autres d put s, des plus c l bres, douard Daladier, Jean Zay, Yvon
Delbos, Andr le Troquer, Pierre Vi not, Pierre Mend s France, C sar Campinchi,
Alex Witzer, Paul Bastid, Gabriel Delattre, Salomon Grumbach, Georges
L vy-Alphand ry, Joseph Denais, Robert Lazurick,jammy Schmidt, le questeur
Camille Perfetti jusqu'aux moins connus, Marcel Brout, Camille Catalan, Bernard
de la Groudi re, Andr Dupont, L andre Dupr , Jean-Marie Thomas. Mais aussi le
d put d'Alger, Jean-Marie Guastavino, celui d'Oran, Marius Dubois, celui du
S n gal, Galandou Diouf, et un s nateur, Tony-R villon. Le personnel
administratif de la Chambre, huissiers compris, avec son mat riel, et le
génél Michel, commandant militaire du Palais-Bourbon, avaient galement t
embarqu s. Sur la passerelle, tr s calme , Mandel annon a ses futurs
compagnons de travers e: Nous partons pour trois ou quatre ans de
r sistance . Campinchi avait r serv les quatre cabines les plus luxueuses pour
lui-m me, Mandel, Daladier et Yvon Delbos, qui avaient cependant d clar se
contenter.de n'importe quelle cabine. L'embarquement fut mouvement . Les
officiers et l' quipage qui, peu inform s, comprenaient mal ce d part,
arboraient une attitude hostile. Les parlementaires furent invit s le soir
s'enfermer dans leurs cabines . La premi re nuit, le Massilia restera l'ancre en rade au Verdon sans nouvelles de
l'ext rieur. [ ]
[ ]
Bordeaux Juin 40 au jour le jour
Par Bertrand FAVREAU
II- LA
CAPITULATION DE BORDEAUX
4. Cesser le combat ,
5. Partir ou ne pas partir
6. L honneur ou la
honte
[ ]
6.
L honneur ou la honte
Ils vont le signer. Dans une heure les
d l gu s fran ais vont le signer. Il va falloir une signature bien nette. Il ne
faut pas qu au-dessous de l acte qui du plus libre pays de ce monde va faire le
plus esclave, il y ait des signatures illisibles .
Jean GIRAUDOUX.
Armistice Bordeaux.1945. p. 9.
Vendredi 21 juin
Oui
mais nous sommes toujours dans l attente notera Herriot. Car, le 21 juin
aura t une journ e d attente Bordeaux. La journ e s'est pass e
attendre ces coups de t l phone. Ce jour-l , Bordeaux ferme ses portes. La
ville est asphyxi e. Il a t d cid de barrer les routes conduisant Bordeaux
et de d tourner les r fugi s vers Langon et Agen. De m me les difficult s de
ravitaillement sont devenues inextricables et l autorit militaire annonce qu'
partir de minuit toute circulation est interdite en Gironde aux v hicules non
immatricul dans le d partement l'exception des automobiles du corps
diplomatique. Peuvent, toutefois, circuler les v hicules militaires d tenteurs,
d un ordre de mission, ceux du service public, les voitures des m decins, sages
femmes, officiers minist riels, repr sentants de commerce, industriels,
commer ants et agriculteurs justifiant d'un concours, l approvisionnement
génél. L interdiction est sans appel : les voitures des contrevenants
seront saisies.
Depuis le 19 juin : la confusion a atteint son
apog e : il faut prendre des mesures dans une ville frapp e d apoplexie.
Dans communiqu la presse, le maire Adrien Marquet, indique que la population
a tripl en moins de deux semaines, que les Bordelais consomment chaque jour
dix tonnes de sucre et 300 tonnes de pain. On chiffre, d j de fa on
excessive - entre 700000 et 900 000 le nombre des habitants. Un gigantesque
embouteillage permanent bloque le Pont de Pierre. La Place Pey-Berland est
devenue le parc de stationnement des v hicules en transit vers l Espagne, ou le
Sud de la France. Voitures remplies de passagers avec sur le toit des lits, ou
des chaises, charrettes, camions : cohue indescriptible. Sur la chauss e
des quais, le stationnement est limit du c t immeuble. On innove : C est le
stationnement altern du c t des num ros pairs. Les trains charg s de
r fugi s, arrivent de mani re continue. La gare abrite toute une population de
femmes, de vieillards et d enfants. On dort partout, dans les autos, sur
les bancs, dans les passages souterrains de la gare saint jean, dans les
squares " la masse humaine
sur le parvis de Saint-Pierre de Rome ou les grandes mar es de la fin d un jeu
de football- jamais rien qui puisse se comparer la foule qui remplissait
cette gare, d bordait sur la place, envahissait les rues voisines. crira Andr Morize. Les restaurants, les boulangeries, les
caf s, sont pris d assaut. Bordeaux est aussi une v ritable sourici re. Ceux
qui y sont entr s, ne peuvent plus en partir d sormais. Il faut multiplier les
appels aux r fugi s qui se rendent la gare avec l espoir de trouver un train.
Depuis le 19 juin, il n y a plus de train, au nord de la ligne de Bordeaux
Avignon. Sur la ligne de Bordeaux S te, on annonce simplement que le trafic
est momentan ment maintenu.
[ ]
Mais o est pass e la d l gation fran aise ?
A six heures trente, le 19 juin,
l'ambassadeur Lequerica s' tait rendu au domicile de Baudouin. Il y avait deux
jours et deux nuits que l on continuait se battre. Le gouvernement du Reich
tait pr t faire conna tre les conditions de la cessation des
hostilit s . Il demandait au gouvernement fran ais de d signer des pl nipotentiaires
cette fin. Il lui sugg rait aussi de ne pas oublier le gouvernement italien
et de se mettre en contact avec lui pour une demande d armistice.
D s huit heures trente, Baudouin rendit
compte au Mar chal P tain du message et les deux hommes se rendirent ensuite
rue Vital-Carles, chez le Pr sident de la R publique pour le Conseil des
Ministres. Il fallut arr ter la liste des pl nipotentiaires. Selon Baudouin,
P tain voulait d signer Chautemps accompagn du ministre des affaires
trang res lui-m me. Le Conseil s y refusa soit qu il ne voulut pas se priver
de deux membres importants pour la d lib ration cruciale qui allait s en
suivre, soit qu il fut convenu de ne pas d p cher de membre du Gouvernement.
A dix heures trente monsieur de Lequerica
avait en poche la liste des pl nipotentiaires pour la transmettre au
gouvernement allemand.
C est cet instant, que Baudouin s avisa
d accompagner la remise de la liste d une requ te : demander Hitler
d arr ter la marche de ses arm es en direction de Bordeaux pour que le
gouvernement fran ais puisse d lib rer avec ind pendance .
Dans la nuit du 19 au 20, peu apr s minuit, Bordeaux
avait t pour la premi re fois bombard . L alerte a dur de z ro quinze
trois heures note Jeanneney. R unis dans l h tel princier
qu occupe Herriot cours Xavier- Arnozan, Herriot, Jeanneney, Blum, durent se
r fugier sous l escalier de pierre et dans les pi ces avoisinantes entre le
couloir d entr e et le hall charbon. Au matin, Albert Lebrun fait avec
Marquet le tour des d combres dans la ville de Bordeaux en tat de
choc : La tristesse et la douleur se peignent sur tous les
visages crit le Pr sident de la R publique qui voque la plus
grande d tresse . Revenu de Munich dans son quartier génél de
Br ly-de-Pesche, Hitler fait durer le plaisir.

20 juin 1940. Le bombardement de Bordeaux.
A cinq heures du matin, la radio allemande a pri la
radio fran aise de rester l coute : le lieu et l heure de la rencontre
lui seront communiqu s par cette voie. Ce n est qu onze heures quinze que le
commandement allemand se d cide faire conna tre qu il attendrait la
d l gation fran aise partir de dix sept heures au pont sur la Loire Tombe.
La lettre de mission n est alors m me pas sign e. Elle le sera juste temps
pour permettre aux pl nipotentiaires de partir apr s une visite l h tel du
pr fet. A quatorze heures trente le m me jour le Pr sident Lebrun doit quitter
Bordeaux.
A onze heures, nouvelle r union l H tel de Ville.
Il y a cette fois-ci quarante s nateurs. Marquet et Bergery rendent compte de
leur visite aupr s du Mar chal P tain faire ajourner tout d part. Le
Mar chal est d accord note Bardoux qui assiste la r union. Bergery se
d cha ne une fois encore, il veut une nouvelle politique trang re et un
changement d quipe. "Il faut maintenant en finir" mais c est avec le r gime tel qu il est.
Laval propose d envoyer une d l gation aupr s du Pr sident de la R publique.
Quatre s nateurs et huit d put s. Bardoux obtient que l ambassade n ait que ce
seul objet et que seul le chef de la d l gation prenne la parole. La d l gation
est compos e Laval, Marquet, Bergery, Pi tri, Monnet, Desoutrolle, Dommange,
Audiffray, Gerentes, Rauzy, et le s nateur Portmann s nateur de la Gironde pour
assurer sa repr sentativit au-del du clan des d faitistes on demande
Barthes, Landry et Octave Crutel de s y joindre.
Cette fois-ci ce n est pas par le mensonge et par le
faux que l on va entreprendre le Pr sident de la R publique. C est par un choc
frontal. A dix sept heures, la d l gation est re ue chez Herriot. Le
discours est tr s net. Il ne s agit pas de transporter les pouvoirs publics en
un autre lieu pour les pr server, puisque de ces pouvoirs publics, il convient
de faire table rase. Bergery parle une fois de plus clairement de
changement de r gime Herriot commente le plan est
maintenant bien net . Un incident violent oppose Herriot Georges
Bonnet. Quelques minutes apr s, la d l gation quitte le cours Xavier-Arnozan
pour se rendre rue Vital-Carles. C est un commando de choc qui p n tre dans
l h tel du pr fet en trombe sans se faire inscrire notera Lebrun
qui gardera longtemps de cette r union un douloureux souvenir . Il
y a de quoi. De cette r union nous avons eu plusieurs narrations, des mots durs
et d finitifs ont t employ s. Laval est d cha n : vous ne pouvez
pas, vous ne devez pas partir. Nous n accepterons pas que par ce biais presque
frauduleux, le gouvernement aille continuer en Afrique un combat qui s av re
impossible . On objecte, la situation n est pas aussi simple le
gouvernement en a d lib r . Il en d lib rera encore Certains peuvent partir
d autres peuvent rester .
C'est Laval qui r pond : "le Pr sident de la R publique en emportant les sceaux de l Etat
emportera avec lui le gouvernement de la France ; il sera le seul ma tre
de la politique. Or, il y a une politique qui a t condamn e par le
gouvernement, c est la politique Reynaud-Churchill. Allez-vous la reprendre
la faveur d un d part en Afrique ? Je ne vous reconnais le droit de le
faire sous aucun pr texte et par aucun d tours Il nous faut maintenant sauver
de ce pays tout ce qui peut tre sauv . Or, ce n est pas en quittant la France
qu on peut la servir."Lebrun tente de r sister : Ne voyez-vous donc pas que le gouvernement
doit rester libre ?
Le d put Ren Dommange
r plique : Monsieur le Pr sident, c est votre gouvernement qui ne
serait plus libre et souverain apr s avoir abandonn plus de quarante millions
de Fran ais, en pleine bataille, sur le sol national. Ces populations
abandonn es constitueraient elles-m mes le vrai gouvernement de la France.
C est nous qui le formerions car nous ne quitterons jamais la France. Et
Laval surench rit, avec violence si
vous quittez cette terre de France vous n y remettrez jamais plus les pieds.
Oui, quand on saura que vous avez choisi pour partir l heure o notre pays
connaissait la plus grande d tresse, un mot viendra sur toutes les
l vres : celui de d fection Peut- tre m me un mot plus grave encore,
celui de trahison Si vous voulez partir c est votre droit ! Mais vous ne
devez le faire qu titre priv . Donnez votre d mission. Laval se
fait patelin pour adjurer Lebrun, dont il soup onne
l ind cision : n coutez plus les conseils de ceux qui ont conduit
notre pays aux ab mes Ah pourquoi pendant si longtemps les avez-vous
suivis ? Lebrun r pond d une voix sans timbre
la Constitution m en faisait un devoir Alors Laval qui ne se
contr le plus lance un cri Je les hais, pour tout le mal qu ils ont fait
la France ! La violence cesse alors. La r union prend un aspect
de c r monie de condol ances. Un un les parlementaires vont saluer Lebrun.
Laval lui serre la main.
Le groupe retourne l H tel de Ville rendre compte
de l entretien que Laval lui-m me qualifie de tr s brutal . Les mots de
trahison et de d mission ont t prononc s. Bergery fait une nouvelle sortie
contre Jeanneney et Herriot. Pierre Dignac, r clame une capitulation totale et
imm diate. Le Chanoine Polimann raconte avec quels effectifs d risoires on lui
a impos de d fendre le passage de l Allier Moulins. Seul Fernand Audeguil,
l ami de L on Blum garde son sang-froid. Il insiste sur le respect des
engagements sign s avec l Angleterre. Le marquis Du Moustier, d put du Doubs,
de retour du front o il s est couvert de gloire parle de ses troupes :
elles, qu il vient de ramener en France, apr s avoir d les rembarquer
Dunkerque veulent se rendre en Afrique pour continuer.
C en est fait, le gouvernement ne partira pas. Sauf
les passagers du Massilia qui, sans
avoir jamais re u de contrordre, ont lev l ancre douze heures trente le m me
jour, et sont d sormais au milieu de l Atlantique. La d cision l che a
gagn note Jeanneney.
[ ]
A quatorze heures, le 20 juin, un cort ge escort de
motocyclistes casqu s est sorti de Bordeaux par le Pont de Pierre. Dans le m me
temps le gouvernement pr pare toujours son improbable d part. Tard dans la nuit
elle est toujours attendue. A dix sept heures elle n tait pas au rendez-vous.
Mais huit heures, le gouvernement fran ais ne conna t toujours pas le lieu o
doivent se rendre les pl nipotentiaires. Elle n arrivera qu un peu avant trois
heures quinze le matin entour e de deux automitrailleuses allemandes, Tours
o le génél Von Tippelskirsch les attend. C est l que le pi ge Chautemps
commence se refermer sur tous ceux qui ne l auraient pas encore compris.
L armistice ne peut tre que la honte.
Transf r e dans des v hicules allemands la
d l gation arrive Paris, dans la nuit du vingt et un o elle est conduite
l H tel Royal Monceau, avenue Hoche, o le troisi me tage lui a t r serv .
Pr vus pour onze heures les pourparlers sont report s quinze heures. En
r alit Hitler a pris depuis plusieurs jours sa d cision. Les pourparlers
d armistice auront lieu sur les lieux m mes o ont eu lieu ceux de 1918. On a
retrouv les pl nipotentiaires fran ais. A treize heures quarante cinq, les
d l gu s fran ais ont t conduits dans la clairi re de Rotonde. Hitler
lui-m me a quitt son repaire pour tre sur les lieux. Il lit un texte aux
d l gu s puis il quitte le wagon. L , le pi ge est inexorablement referm . Vers
19 heures, Bordeaux, on a appris par un communiqu D.N.B. que c' tait
Rethondes qu'avaient t conduits les pl nipotentiaires.
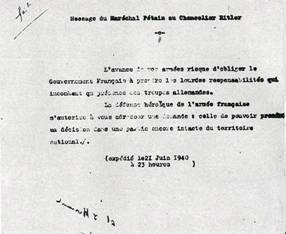
Le 21 juin 23 heures
"le Mar chal P tain au Chancelier Hitler"
" pendre [s]a
d cision dans une partie encore intacte du territoire national."
A 20 h. 20, la communication t l phonique
enfin tablie entre Rethondes et Bordeaux, le génél Huntziger appelle le
génél Weygand l h tel de la rue Vital-Carles. Vous devinez o je suis...
je suis dans le wagon . Les conditions d armistice vont tre donn es. Le
gouvernement est toujours Bordeaux. Il n y a plus d autre choix que
d accepter les conditions d armistice ou d tre fait prisonnier. A vingt et une
heures, le Mar chal a adress une requ te pressante : l tablissement
autour de Bordeaux d une large zone de s curit afin que le gouvernement ne
soit pas en pr sence des troupes ennemies. [ ]
D s vingt deux heures la r alit est claire :
c est le d shonneur et la subordination. Charles-Roux le premier r crimine. Les
conditions sont inacceptables, il en est tout aussi conscient que les autres.
Il vaut mieux d s lors partir pour l Afrique du Nord. Encore ! s exclame le Mar chal P tain pr t
s accommoder et levant les bras au ciel. Des amendements sont propos s :
sortir Paris de la zone d occupation, discuter les clauses navales, refuser de
livrer les r fugi s politiques.
A z ro heure trente, le 22 juin, le Conseil des
Ministres se r unit ensuite vers l h tel du pr fet. Les conditions d armistice
sont d sormais d voil es l ensemble du Conseil et non plus un petit groupe
restreint. Les partisans de l armistice sont alors confront s une r alit
vidente : contrairement au jugement de valeur d Huntziger, les conditions
sont contraires l honneur. Albert Lebrun les juge inacceptables. Il n est pas
le seul. Selon Baudouin Chautemps r crimine (r alise t il que son propre pi ge
se referme sur lui ?) et Darlan, quant lui parle de "r sister".
Chautemps dit lui-m me qu il s agit d un
affreux document : les conditions taient non seulement tr s
dures mais ajoute t il on
tait plus frapp encore de leur r daction hypocrite et sp cieuse, destin e
viter de fournir un aliment l esprit de r sistance . Weygand
lui-m me, l homme qui avait tant voulu l armistice depuis le 12 juin, entrevoit
le spectre de la honte. Il s crit : On
ne peut pas n gocier, d abord, avec les Allemands, ensuite avec les Italiens,
sous la pression de troupes du Reich, s avan ant marche forc e en direction
du sud, vers l estuaire de la Gironde et Bordeaux . Mais tout le monde
se r signe bien vite. Lebrun gardera le souvenir d une grande motion, mais
selon lui, la m thode de travail du Conseil se passe de
commentaire : apr s un examen d ensemble le Conseil d cide
d accepter le principe. Puis on proc de une tude du texte en
d tail . A trois heures du matin la s ance est lev e, chaque ministre a
re u une copie des conditions d armistice. Les observations sont recueillies
par le génél Weygand : la seule mesure possible e t
t le rejet en bloc de l armistice. Il tait de plus en plus clair que ni le
Mar chal ni son entourage n en envisageaient plus la possibilit .
L'examen commenc vers 21 heures prit fin vers minuit et demie.
Le Conseil des Ministres se r unit nouveau le
lendemain matin. C est le deuxi me Conseil des Ministres destin tudier les
conditions de l armistice. Plus r aliste que celui de la nuit, il pose tout
d abord une question, dont la solution est h las rendue plus urgente que
jamais. L avance de l arm e allemande est toujours foudroyante et le Conseil
entend que soit r gl au pr alable l arr t de la marche des troupes allemandes.
Quant au texte de la convention d armistice, trois modifications de principe
sont demand es. Elles portent sur les articles ayant trait la zone
d occupation (article 2 : modification du trac de lignes d limitant la
zone occup e). Le gouvernement voudrait obtenir que Paris reste libre. Pour
cela il propose que la capitale soit vacu e par les troupes allemandes et soit
reli e la zone libre par un corridor form par la lib ration de six
d partements, la Seine, La Seine et Oise, la Seine et Marne, le Loiret, le Cher
et le Loir et Cher. La deuxi me se rapporte la mention des avions militaires
sur la liste du mat riel dont la livraison en bon tat pourrait tre exig e. Le
gouvernement demande que les avions militaires soient ray s de cette liste
c est une contre-proposition : qu ils soient d truits. La troisi me
r serve a trait la livraison des ressortissants allemands. Le gouvernement
qui est donc bien conscient la d clare qu il la consid re comme contraire
l honneur, en raison de la pratique du droit d asile et demande en cons quence
la suppression pure et simple. Quant aux autres modifications demand es, elles
ont trait la livraison du mat riel de guerre (article 5), la flotte (article
8), le ravitaillement génél (article 17), la validit de la convention
(article 23), le sort des arm es alli es combattant en France.
En ce qui concerne la flotte de guerre l article 8
d cide qu elle sera rassembl e dans ses ports d attache du temps de paix et
d mobilis e et d sarm e sous contr le. Charles-Roux a communiqu
l ambassadeur Campbell les grandes lignes des conditions allemandes d s qu il
en a re u une copie. Il s est mu de la clause relative la flotte et a fait
passer au Conseil des Ministres en pleine s ance une note br ve attirant
l attention sur son caract re insidieux. Il y voit un traquenard pouvant
aboutir la mainmise des allemands et des italiens sur les b timents de guerre
qui rappelle les promesses qui ont t faites son pays.
A neuf heures trente, une demi-heure apr s l heure
fix e pour donner la r ponse du gouvernement, les contre-propositions sont
dict es par t l phone au génél Huntziger depuis Bordeaux. A la Rotonde,
Keitel admit que les avions pourraient ne pas tre livr s. Il accepta que le
Reich se contente de r clamer parmi les r fugi s politiques les seuls
incitateurs la guerre , terme vague qui permettait
ult rieurement toutes les interpr tations. Et le Conseil se r unit nouveau de
quatorze heures seize heures trente. Et l , Keitel n y tient plus. Il lan a
un ultimatum expirant dix huit heures trente qui s il n y avait pas de
signature avant cette heure il faudrait supposer qu il n existait chez les
fran ais aucune volont de conclure.
Un quatri me Conseil des Ministres se r unit de dix
sept heures trente dix huit heures trente. A dix huit heures trente, Weygand
donne l Ordre de signer l'armistice. La convention d armistice est sign e le 22
juin 1940 18 h 50, heure d t allemande. Le génél Keitel a dit
Huntziger il est honorable pour un vainqueur d honorer son
vaincu. Et on se leva pour saluer la m moire des morts.
A 22 h30 parvient Bordeaux, l'ordre de Hitler de
laisser "Bordeaux en dehors des
sones de combat aussi longtemps que dureront les n gociations sur l'Armistice
conclure entre le Gouvernement fran ais et le gouvernement italien"
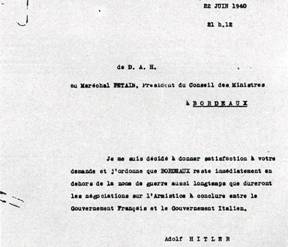
La r ponse de Hitler. 22 juin 1940. 21 h 12.
[ ]
[ ]
Bordeaux Juin 40 au jour le jour
Par Bertrand FAVREAU
III
LE GOUVERNEMENT DE BORDEAUX
[ ]
7. Notre drapeau reste sans tache.
8. La lutte contre
la dissidence
9. Un Ordre nouveau
7.
Notre drapeau reste sans tache.
[ ]

La Petite Gironde.
23 juin 1940.
Dimanche
23 juin 1940 -
Hitler atterrit Paris pour visiter la Ville - Pendant ce temps l ,
Bordeaux, Laval et Marquet entrent au gouvernement... Ministres sans
portefeuille. Avant de quitter le sol fran ais, Campbell a fait parvenir
Lebrun l'ultime adjuration du roi d'Angleterre. Tandis qu'il se rend vers
Saint-Jean-de-Luz pour gagner l'Angleterre, la question anglaise est au matin
du 23 dans toutes les t tes. L'armistice est sign . Encore faut-il convaincre
les fran ais de son bien fond . Weygand dira que rien n'a t conomis pour y
parvenir.
[ ]
Le retour de Laval et de
Marquet
Laval n'a cess de montrer la fois son soutien et son emprise
croissante sur la partie des s nateurs et des d put s rest s Bordeaux.
Marquet a accompagn Lebrun tout au long de la matin e du jeudi 20 dans son
hommage aux victimes du bombardement. Tous deux ont pleinement conscience que
la signature de l'armistice correspond leur heure de gloire et que ce qu'il
leur a t refus le 16 au soir, ne peut plus leur chapper. Tout ce qui ne
paraissait pas possible le 16 juin l' tait devenu le 23. Le 22 juin,
l'Ath n e, tout pr s de la pr fecture, Laval faisait voter une motion toute
vibrante de confiance au Mar chal.
Le soir, Laval et Marquet ont rendu visite P tain, boulevard Wilson,
apr s n'avoir cess de lui envoyer tout au long de la semaine, des missaires.
Un projet de d cret est port Lebrun, d s le 22 au soir, en vue de signer
leur nomination. Mais c'est un membre obscur de la pr sidence du Conseil qui le
pr sentait. Lebrun n'a pas encore compris malgr la sc ne douloureuse v cue
la veille - qu'il n'est d j (presque) plus rien mais il tient aux formes
constitutionnelles. Il veut que les "nouveaux collaborateurs"
(le mot est de lui) soient pr sent s par le Pr sident du Conseil. Le lendemain,
il signera le d cret que lui apporte le Mar chal lui-m me, m me s'il rechigne
au point que P tain avouera qu'il a "eu de la peine lui faire signer
les deux d crets".
A 10 heures, le Mar chal fait son entr e au Conseil des Ministres,
encadr par Laval et Marquet, ministre d'Etat."La signification de ces
nominations tait assez claire" notera apr s coup Chautemps. A
Baudouin qui se d clarait "boulevers ", (du moins l' tait-il en
1948), le Mar chal r pond : "je ne pouvais agir autrement, il faut que
je le fasse entrer dans le gouvernement o ses intrigues seront moins
dangereuses que s'il cr ait une opposition l'ext rieur". Le Mar chal
va plus loin : il franchira les quelques m tres qui s parent la rue Vital
Carles de la Facult de droit pour se rendre aupr s de Baudouin et de
Charles-Roux : "Il veut adoucir l'amertume de l'entr e de Pierre Laval
dans le gouvernement". Toujours selon Baudouin, Weygand est furieux et
Bouthillier, mu. Quant Charles Rous, qui s' tait oppos la nomination,
le16 juin au soir, il commente : "Je
n'ai donc retard que d'une semaine son entr e au gouvernement et de quatre
mois son arriv e aux Affaires trang res".
[ ]
Un manque absolu de
sang-froid
D s le matin Baudouin a pris connaissance du discours de Churchill qu'il qualifie
de "termes violents et injustes". Baudouin, qui pr tend qu'il
a voulu tout prix maintenir "l'alliance
anglaise contre vents et mar es" a pr par un projet de t l gramme en
r ponse.
Avant le Conseil des Ministres, il le pr sente au mar chal P tain. Mais
il y a un homme nouveau ce jour-l au gouvernement. Laval qui vient de
d clarer Bardoux quelques minutes plus t t qu'il ne connaissait pas les
conditions d'armistice est arriv avec le texte du discours de Churchill la
main. Un vent nouveau souffle d sormais sur la nouvelle politique et Laval
clate. Il pr conise une rupture violente pour c l brer l' re nouvelle.
Baudouin pr tendra qu'il est oblig de mettre sa d mission dans la balance, et
de se porter fort pour celle de Weygand et de Darlan afin d'obliger le mar chal
inviter Laval se calmer.
Au Conseil des Ministres qui suit, l'incident n'est pas clos. Le Conseil
est vivement " mu" : le génél de Gaulle vient de lancer non
plus un appel la r sistance mais un "appel la r bellion", ce
que dans quelques jours, on appellera "la dissidence". Laval
omnipr sent, refait sa sortie anti-anglaise et demande le rappel de
l'ambassadeur. Finalement, le texte du t l gramme de protestation de Baudouin
est adopt "le gouvernement fran ais met le plus vif regret d'une
d claration qui d note un manque absolu de sang-froid". Absolu de sang froid devant
s'interpr ter au regard du lexique s mantique bordelais de juin 1940. Et le
t l gramme poursuit en reprenant la version Baudouin de la position de Churchill
des 11 et 13 juin devant se terminer par : "le premier Ministre se
trompe ; il n'y a pas de gouvernement de Bordeaux. Il n'y a que le gouvernement
de la France, appuy sur le sentiment et l'adh sion des fran ais". Le
texte en sera paraphras et pr sent sous la forme d'un communiqu remis la
presse assorti d'une protestation plus ferme et plus formelle en m me temps que
d'un appel l'opinion publique britannique qui "comprendra lorsqu'elle
en sera inform e". Le discours du Premier britannique ne peut rester
sans r action et c'est au Mar chal d'exprimer lui-m me sa "stupeur
attrist e". Ce sera le dimanche 23 au soir. C'est le troisi me
discours de Bordeaux.
Le discours est dress sur le m me plan : Churchill, mu par "l'angoisse
et chacun est invit comprendre qu'il redoute pour son pays les mots qui
accablent le n tre depuis un mois". Churchill n'est pas juge de
l'honneur fran ais. "Notre drapeau
reste sans t che. Notre arm e s'est bravement et loyalement battue" La
France a m rit le respect du monde. L'hymne se mue en un chant de la terre de
France : "Le champs du paysan d vast par la gr le .Le m me
sillon pour les grains futurs". Et s'ach ve par un vibrant hommage
la "grandeur avouer sa
d faite". Au soir du 23, les pr cautions de Pierre Laval auront t
vaines : Londres, l'ambassadeur Charles Corbin a fait conna tre sa d mission.
[ ]
L'armistice avec
l'Italie.
Il convient aussi de rassurer ceux qui
ont compris que l'armistice tait contraire l'honneur d'un pays. Un second
Conseil des Ministres s'est tenu le 23 juin 17 heures 30, il est consacr
la possibilit d'une d fense en Afrique du Nord, selon Pomaret. On attend des
nouvelles de Rome.
L encore, Hitler s'est donn le temps.
Apr s avoir refus la n gociation tripartite que voulait Ciano, il a expos
lors de sa rencontre avec Mussolini pourquoi il fallait se montrer conciliant
avec la France. Ribbentrop de son cot , devenu "calme, mod r et
pacifiste", s'est charg d'exposer
Ciano pourquoi il fallait viter d'acculer Fran ais un transfert du
gouvernement Londres ou Alger et un d part de la flotte vers l'Angleterre
o les Etats-Unis. La flotte fran aise
doublerait les possibilit s de la flotte britannique et il tait plus habile de
parvenir un accord pr voyant la neutralisation des les ports fran ais sous
contr le allemand et italien. Une troisi me rencontre avait eu lieu laquelle s' tait joints Keitel et le
génél Mario Roatta pour pr ciser qu'il tait important d'assurer le maintien
en France d'un gouvernement fran ais, seul responsable.
Le 23 juin, 4 heures, les
pl nipotentiaires fran ais ont t transport s bord de Junker de l arm e
allemande Rome, o la d l gation fran aise a t conduite la Villa Manzoni.
A 19 heures 30, elle a rencontr les pl nipotentiaires italiens. A 23 heures,
les conditions italiennes sont transmises Bordeaux et Baudouin d clare avoir
pris connaissance "avec satisfaction" des clauses concernant
l'occupation des territoires. Pour Pomaret aussi c'est un vif "soulagement". En tout tat de
cause, les conditions taient accept es d'avance y compris avec l'occupation de
la Savoie et de Nice, selon Pomaret. Car, nul ne se dissimule plus la seule
r alit : il n'y a plus de possibilit de discussion. Depuis le 23 au matin,
Bordeaux est encercl , ainsi que Pomaret l'a annonc Paul-Boncour.
Puisqu'il n'y a pas on le sait depuis
la veille de possibilit de refuser, il suffit donc de s'accommoder en
d dramatisant.. D s lors les commentaires convergent et surench rissent pour
louer l'exemplarit du comportement de l'adversaire.. On met en exergue la
"cordialit "
("non souhait e au demeurant) de l'accueil, selon L on Noel.
Pour des raisons que certains se plaisent attribuer la pr sence du Mar chal
Badoglio, les discussions sont "plus
ais es", ainsi que le notera Lebrun, qui ne fera quant lui, aucun
autre commentaire sur les conditions d'armistice, sinon pour voquer le
souvenir des grandes man uvres en 1935 aux c t s du Mar chal italien, lors du
Conseil des Ministres qui s'est r uni le 24 juin 8 heures.
Ce matin du 24 juin, il s'agit de donner
le ton, pour diriger ou emp cher la discussion: le 22, Weygand s'en tait
charg , cette fois-ci, c'est Baudouin qui d clare d'entr e, comme pour pr venir
toute vell it de discussions inutiles ou dilatoires "que les demandes italiennes sont pleinement acceptables".
Acceptables ? Les membres du Conseil pourtant semblent frapp s de stupeur.
Lebrun exprime encore un ultime "d sappointement"
qui est mis sur le compte de son d sespoir. Mais pour Baudouin, il s'agit l
"du moindre mal", de m me que Laval disait Bardoux, deux
jours plus t t, que cela ne pouvait tre mieux. Toutefois il y a deux clauses
qui sont consid r es comme contraires l'honneur : l'article 9 qui pr voit la
d mobilisation et le d sarmement de la plupart des troupes d'Afrique du Nord et
de Syrie et l'article 21 qui, l'instar de celui de l'armistice allemand,
pr voit la livraison des ressortissants italiens. Et s'il y a bien d'autres
remarques mais elles sont de pure forme.
Toutefois, en termes d'honneur, ce qui
pr occupe Baudouin, c'est l'article 9,
"le seul qui accroche". Apr s 45 minutes du Conseil des
Ministres, Weygand et Baudouin en compagnie de Darlan sont charg s de r diger
des contre-propositions. Elles sont soumises un nouveau Conseil des
Ministres 10 heures, qui, en une demi-heure approuve l'ensemble des
contre-propositions. M me si on ne le dit pas, on sait que la marge de
n gociations est quasiment nulle. On se rabat alors sur les sollicitations.
C'est nouveau Lequerica que l'on appelle pour lui demander instamment
d'intervenir aupr s du gouvernement italien pour viter la d mobilisation des
troupes d'Afrique. On lui expose qu'il s'agit de pouvoir lutter contre les
r bellions soutenues par l'Angleterre, c'est dire l'ennemi de l'Italie et de
l'Allemagne. La demande n'est pas pr sent e dans l'int r t de la France mais
dans celui-l m me de l'Italie. Mais cela reste pour la forme, car l'armistice
avec l'Italie doit tre accept . Et Baudouin, lui-m me, en est tellement
convaincu qu'il se rend d s 14 heures chez le Pr sident de la R publique, rue
Vital Carles d j d cid en terminer avec la n gociation, oubliant que sa
r ponse est parvenue en fin de matin e seulement Huntziger et ne sachant pas
qu' Rome la n gociation ne pourra reprendre qu' 15 heures 40. Les
discussions sur l'article 9 vont avoir lieu : un argument nouveau est mis dans
la balance par la d l gation fran aise : "il s'agit de ne pas priver
d'un moyen de maintien de l'ordre la France dans des pays indig nes o
l'autorit du blanc ne doit pas tre bafou e". Sans doute a-t-on jug
que les italiens ne pouvaient qu' tre sensibles ce type d'arguments racistes
puisqu'ils acceptent la modification. Mais il n'y aura pas de modifications
quant la flotte. Et quant
l'article 21 : "Il d pend du gouvernement". La s ance a t
suspendue 17 heures 10. Le temps presse pour tout le monde. A 17 heures 30,
on fait savoir la d l gation que les demandes sont accept es par les italiens
et Baudouin crit "Nous sommes arriv s un accord".
A 19 heures 10, Weygand t l phone l'ordre
- num ro 61/DM - de signer la convention d'armistice avec l'Italie. A 19
heures 15, les signatures sont appos es. Le d lai de 6 heures ne commencera
courir qu' partir de la notification de l'accord au gouvernement allemand qui
interviendra 18 heures 35, heure d' t allemande..A 0 heure 35, dans la nuit
du 24, les combats cesseront. Hitler adresse un communiqu de victoire au
peuple allemand. Pour les militaires, c'est l'adieu aux armes : le génél
Weygand s'appr te adresser le dernier ordre du jour aux arm es : le
communiqu 589. Puis un autre qui r sume tous "les adversaires ont tenu
rendre hommage vos vertus guerri res dignes de nos gloires et de notre nation.
L'honneur est sauf. Soyez fiers de vous."
[ ]
Requiem pour un r gime d funt.

25 juin. Service fun bre
en la Cath drale Saint-Andr de Bordeaux.
A 0 heure 35, le 25 juin, l'armistice est
entr en vigueur. A Bordeaux comme ailleurs, sur le territoire fran ais,
l'expiation commence par une journ e de deuil national. Le Ministre de
l'Int rieur, Charles Pomaret en a r gl
tous les d tails. A 9 heures du matin, Baudouin a re u la presse. Pomaret suit
dans la matin e, la radio il annonce : une
nouvelle vie commencera pour la France. Chaque homme militaire ou civil sera
remis sa place... . La patrie bless e doit remettre de l'ordre dans ses
affaires.
Mais le grand moment du 25 juin, c'est le
service fun bre de la cath drale Saint-Andr de Bordeaux. La France se
recueille pour s'abreuver de sa d tresse et retremper son courage. Depuis 9
heures du matin, la nef tendue de noir s' tait remplie. Il n'y avait pas de
places pour les parlementaires, toutes avaient t prises d'assaut par les
repr sentants des bribes des gouvernements qui parcouraient Bordeaux. C'est un
office fun bre : un c notaphe a t dress dans l'all e centrale, recouvert
d'un drap noir bord d'argent et entour de cierges allum s. Un important
service d'ordre maintenait la foule aux abords de la primatiale sur la Place
Pey-Berland.
A 10 heures, devant les portes de la
primatiale, l'Archev que de Bordeaux, Monseigneur Feltin, accueillait un un
les membres du gouvernement, le corps diplomatique les Pr sidents des
Assembl es et le Mar chal P tain qui s'y rendaient en civil dans un costume
noir. Il est entour de Chautemps, de Laval et Marquet. Puis Raynaud les suit,
pr c dent de peu le génél Weygand. Tout ce que Bordeaux abrite alors de corps
diplomatique participe la fun bre procession. Tous s'installent, "chacun
son rang", selon Chauvel. Toute mondanit n' tait pas absente : on pouvait voir dans
l'une des trav es la Mar chal Lyautey et Madame Weygand "papoter avec
animation". Le calvaire de la France commen ait "sous
ses vo tes lev es la gloire de l'ap tre de la croix".
Comme dans
tout service fun bre l'archev que a tenu attendre pour p n trer le
dernier dans la nef, pr c d du chapitre de la cath drale. Enfin, c'est l'arriv e
du Pr sident de la R publique entour des membres de sa maison civile et
militaire. Un vide oppressant, un silence s pulcral de l'assistance debout,
scrute le passage du cort ge d'Albert Lebrun. Les grandes orgues soufflent dans
la nef une musique de mort. Le Pr sident
et les membres du gouvernement "visiblement affect s" prennent
place droite de l'autel dans le ch ur en face du tr ne archi piscopal.
Puis c'est l'hom lie de Monseigneur
Feltin. Il monte en chair pour voquer le sacrifice des morts "victimes
d'une patrie humili e". "Si nous avons t vaincus, c'est que,
peut tre, nous n' tions plus suffisamment soutenus, au fond de nos mes par ce
triple id al de son trois grandes r alit s : Dieu, la Patrie, la famille".
Lente vocation du "devoir difficile auquel il faut se consacrer
demain" et il annonce : "Vous
allez entrer dans un ordre social nouveau...", avant que le Vicaire
génél du dioc se ne donne l'absoute."La
foule est prostr e de douleur et de d sespoir" dira Lebrun. "C r monie triste comme l'heure que
vivait la France" pour Bouthillier. Pour Chautemps, c' tait la c l bration de la "douleur et
de l'esp rance fran aises". "Et les larmes brillaient dans tous
les yeux" crira la petite Gironde du lendemain qui conclut "aucun
de ceux qui auront eu l' mouvant privil ge d'assister cette c r monie n'en
perdra le souvenir de sa vie".
Charles-Roux, lui, n'a vu aucune
grandeur dans cette c r monie expiatoire destin e marquer les esprits : "J'ai rarement vu c r monie plus
mesquine. Pompe mesquine, contrastant avec le cadre architectural, chants et
musique au dessous du m diocre; apr s l' vangile, froid discours de
l'archev que, lisant un papier; tout un cot du c ur encombr par le groupe
composite du gouvernement, o se reconnaissait d j la transposition d'un
r gime un autre. Ce qu'on appelle "l'atmosph re" n'y fut pas. Dans
l'assistance ne passa pas ce courant ind finissable, qui cr l' motion. A la
sortie, en troupeau derri re les officiels, parlementaires et journalistes
parlaient politique" ajoute Charles-Roux. Baudouin, dont les
"yeux sont plein de larmes", dit-il,
ne manque pas d'observer au m me instant, des passants qui traitent
Herriot et Jeanneney de "salopards".
A, onze heures, une autre c r monie a
lieu devant le monument aux morts, c t de l'Eglise Saint-Bruno.
Ce soir l , apr s Baudouin, apr s
Pomaret, le matin, c'est au Mar chal qu'il appartenait de conclure cette
bataille des ondes. A 21 heures 30, le mar chal explique au pays les causes de
sa d faite. Avec le concours pr t par Emmanuel Berl, le discours r sume la
doctrine du nouveau gouvernement. Le gouvernement tait accul l'une de ses
d cisions : demeurer sur place ou prendre la mer... il en a d lib r et s'est
r solu rester en France pour maintenir l'unit de notre peuple et le
repr senter en face de l'adversaire. Il s'en prend ces quelques fran ais mal
instruits des conditions de la lutte. Et d signe la vindicte publique contre
laquelle maintenant il convient d'entrer en guerre : "ce n'est pas moi
qui vous bernerai par des paroles trompeuses; Je hais les mensonges qui vous
ont fait tant de mal".
"Vous avez souffert et vous
souffriez encore. Votre vie sera dure... N'esp rez pas trop de l'Etat ; il ne
peut donner que ce qu'il re oit. L'esprit de jouissance a d truit ce que
l'esprit de sacrifice a difi . Je n'ai plac hors du sol de France ni ma
pens e ni mon espoir. Mais il y avait un mot
qui r sumait tous les autres "un ordre nouveau commence".
Pleurs, humiliation, douleur, tristesse, souffrance, sacrifice. Le 25
juin a donn le ton .
[ ]
La lutte contre la
dissidence
[ ]
S' loignant chaque heure davantage de Bordeaux,
toujours coup du monde, le Massilia avait poursuivi sa travers e vers Casablanca.
Dans la nuit du 22 au 23 juin, la radio du bord re ut cependant l'annonce de la
signature de l'armistice. Le t l gramme
tait sommaire: aucune indication sur le contenu et sur les clauses". Le génél Michel se chargea d'annoncer la
nouvelle aux parlementaires dans le fumoir du paquebot. je suis d sesp r ,
nota Tony-R villon. Campinchi, plus
direct, fulmina: Ah! les s.... ils ont fait a! Quant Mandel,
retir dans sa cabine, il apprit la nouvelle encore en faux col [... ] et
avec ses immuables gants gris , par Delattre.
Pointant alors sa main gant e de gris vers sa malle noire, qui contenait
le buste en bronze de Clemenceau, qu'il avait t contraint de laisser dans le
couloir, il proclama dans une rage froide : Celui-ci les accuse et les
m prise! - impr cation que Delattre, alors mal inform du contenu de la
malle, prit pour un propos irraisonn d l' motion". Or, jusqu'au dernier moment, Mandel avait
refus de croire qu'un armistice f t possible. Il n'y aura pas un Fran ais
pour mettre sa signature au bas d'un pareil document , avait-il dit B atrice
Bretty, comme il l'avait dit Philippe Roques et Andr Stibio. Plus encore, il avait annonc lie Bois que
s'il devait y avoir une paix honteuse , lui, Mandel, ne serait pas de cette
paix-l . Il fallait d sormais se rendre l' vidence: les passagers du
Massilia, prisonniers au milieu de l'oc an, taient pris revers . Les
flancs du paquebot se refermaient sur eux comme un pi ge. La nouvelle de l'armistice, ressentie comme
un coup de poignard dans le dos, modifiait leur position. Ce sentiment tait, plus que tout autre,
celui de Georges Mandel, qui tait parti vers l'Afrique du Nord pour continuer
le combat. Or la France avait accept la
d faite et les conditions de l'ennemi.
Il n'y avait d sormais plus de possibilit de revirement
gouvernemental. Il tait clair, en
outre, que la crainte d'une capture du gouvernement avant la fin des
n gociations, qui avait permis de rallier, apr s le 17 juin, l'id e d'un
d part m me les partisans de l'armistice, disparaissait avec sa signature. Le gouvernement n'irait pas en Afrique du
Nord. Conscients du bouleversement de
leur situation, les vingt-sept parlementaires se r unissaient dans le salon de
lecture du Massilia. La r union restait
confuse. Les attitudes divergeaient:
poursuivre le voyage, rentrer Bordeaux afin d'agir sur le gouvernement. La position de Mandel restait inchang e: plus
que jamais l'Afrique du Nord offrait une perspective de continuer la lutte. Il semblait que de fa on diffuse sa position
l'emportait.
C'est lui, en effet, qui fut charg de r diger, sur
une feuille arrach e à un carnet de poche, le texte d'un message destin au
génél Nogu s:
... d l gu r sidence généle Rabat.
Paquebot Massilia arrivera demain d but matin e, ayant son bord
vingt-sept parlementaires partis sur instruction du gouvernement, dont MM. Mandel, Campinchi, Delbos, Daladier, Vi not,
etc. Stop. Vous prie de nous faire parvenir l ments
d'information sur situation généle et prendre imm diatement dispositions pour
transport ventuel Rabat cent vingt personnes avec bagages.
D l gation.
Excipant des r glements du temps de guerre, le
commandant Ferbos d clara qu'il ne pouvait mettre aucun message radio pour ne
pas prendre le risque d'un rep rage des sous-marins. Des sous-marins, il semblait y en avoir
justement. Ce sera la seule animation du
voyage, mais la premi re inqui tude pass e, ils se rabattront sur une autre
cible. Campinchi tenta alors d'obtenir
du commandant qu'il mette le cap sur l'Angleterre. Mais le commandant refusa d'envisager que le
bateau soit d rout sans l'accord d'un quipage qu'il savait divis . Alors que le navire longeait d j les c tes
du Maroc, une deuxi me nouvelle parvint aux passagers: l'entr e de Laval et de
Marquet au gouvernement, le premier comme vice-pr sident du Conseil, le second
comme ministre d'Etat. Les derni res
chances de r sistance du gouvernement s'effondraient. Seul demeurait comme une esp rance le
commandant en chef des forces de l'Afrique du Nord, le génél Nogu s.
Le 24 juin, 7 h 45 du matin, le Massilia
faisait son entr e dans le port de
Casablanca et accostait au m le du commerce. Les vingt-sept parlementaires qui
taient son bord ne repr sentaient plus qu'eux-m mes. Passagers du navire que Gringoire allait
rebaptiser le paquebot Trouillacity , ils ignoraient alors que la presse de
Vichy allait faire d'eux des tra tres, des embusqu s, des fuyards. Jean Prouvost, l'ancien ministre de
l'information de Paul Reynaud, devenu le haut commissaire la Propagande de
P tain avait donn le ton, d s le 24 juin, en d clarant la radio : " En fuyant les responsabilit s qu'ils
ont assum es vis- -vis de la Nation, ils se sont retranch s de la communaut
fran aise. Le génél Le Brun, commandant la subdivision de Casablanca, monta
bord du Massilia pour accueillir les passagers. Des larmes d' motion mont rent leurs yeux
lorsqu'ils entendirent le génél Le Brun leur déclarer: Nous sommes tous
pr ts nous grouper autour de vous pour la d fense de la Patrie. La terre
d'Afrique du Nord allait-elle se r v ler le foyer salvateur de la Patrie? La foi renaissait. L'espoir serait de courte dur e. Le texte du t l gramme du 23 juin, actualis
en raison de l'arriv e Casablanca, fut remis aux autorit s du port pour
exp dition Bordeaux, mais Police-Navigation, la police de la marine d' tat,
donna ordre de ne pas le transmettre.
Des policiers, sous les ordres de Maurice Fourneret, directeur de la
S ret , proc d rent au contr le des passagers.
Les fusiliers marins, les militaires et m me le génél Michel furent
autoris s quitter le navire. Les
autres passagers furent somm s de ne pas descendre jusqu' nouvel ordre: ils
taient consign s bord. force de d marches, Mandel, Campinchi, Daladier et
Vi not obtinrent l'autorisation de se rendre au bureau de Police-Navigation,
mais sous la surveillance de marins en arme.
Devaient-ils se consid rer comme prisonniers? L'amiral d'Harcourt, commandant la marine au
Maroc, restait vague. Le génél Nogu s
n'avait pas donn d'instructions. Les
parlementaires furent invit s patienter et regagner le Massilia.
11 h 15, son arriv e de Rabat, monte sur le
pont Jean Morize, ministre pl nipotentiaire, d l gu la r sidence de
Rabat. Il est le secr taire génél de
la r sidence. l'annonce de l'accostage du Massilia, il a t l phon au génél
Nogu s, qui est Alger. Il a re u ordre
de se rendre de Rabat Casablanca.
Morize est harcel de questions sur les clauses de l'armistice. Selon Mandel, c'est lui qui indique les
conditions allemandes, entendues la B.B.C., et qui apprend aux passagers le
mouvement organis par le génél de Gaulle.
Et c'est en r ponse ce r cit que Mandel l'interrogera sur les
relations avec la Grande-Bretagne. Ce
premier contact n'est pas mauvais, Morize d jeune sur le Massilia. Mandel obtient la mise disposition d'une
voiture de la R gie de l'exploitation industrielle du protectorat (R.E.I.P.)
pour l'apr s-midi. Apr s le d jeuner,
Mandel peut m me effectuer des courses dans Casablanca. La police note qu'il s'est renseign dans une
chemiserie, le Carnaval de Venise , sur les sentiments de la population .
Puis, Daladier et lui se rendent Rabat, accompagnés du directeur de la S ret ,
Maurice Fourneret, qui monte c t du mécanicien , le chauffeur Battini,
17 h, la r sidence,
Is
rencontrent le chef du cabinet civil du génél Nogu s, Yvan Martin. Ils veulent tre mis en communication avec le
génél Nogu s Alger. Le chef de
cabinet est courtois mais peu disert. En
l'absence du génél, Daladier demande rencontrer Mme Nogu s, qu'il conna t,
tandis que Mandel d cide d'aller voir le consul génél de Grande-Bretagne,
dans l'espoir de recueillir des nouvelles , dira-t-il. 17 h 20, Yvan Martin
t l phone au consul génél Hirst pour lui annoncer la visite de Mandel, qui y
sera amen dans la voiture du protectorat, guid par Fourneret. De ce qui s'est dit entre le consul et Georges
Mandel, nul ne le saura jamais. je ne lui cachais pas que j' tais assez
perplexe et que mes r solutions ult rieures d pendraient des v nements [... ].
Notre conversation ne pourrait pr ter aucune quivoque, je venais
exclusivement pour me renseigner , se bornera admettre Mandel. . Et il ajouta qu'en tout tat de cause, apr s
un entretien d'une vingtaine de minutes (une demi-heure trajet compris, selon
le commissaire qui l' piait la demande de Morize), il rejoignit la r sidence,
alors que Daladier conversait encore avec la généle Nogu s.
Quelques instants plus tard, Daladier et lui
pouvaient t l phoner au génél Nogu s du bureau de son chef de cabinet. Selon Yvan Martin, Mandel se serait exclam
en coutant la conversation de Daladier avec Nogu s: Ah! il croit au
gouvernement de Bordeaux! ; puis, prenant l'appareil des mains de Daladier, il
aurait lanc : Mais, Bordeaux, cela ne signifie rien Aujourd'hui Nogu s
h site et balance. Demain, il
ob ira. Il arr tera Mandel , a crit un
autre t moin de la sc ne, J. Le Templier.
19 h 30, au soir du 25 juin, jour de deuil
national, un hydravion Sonderland avait amerri, au prix d'une prouesse du
pilote, Rabat, sur l'oued Bou-Regreg demi ass ch , mais proche du consulat
britannique. Il transportait, comme
annonc , le ministre britannique de l'Information Duff Cooper, et lord Gort,
ancien commandant du corps exp ditionnaire britannique en France, envoy s par
Churchill pour rencontrer Mandel.
Accueillis par le génél Dillon, attach militaire britannique charg
de la liaison avec Nogu s, ils devaient vite comprendre qu'ils allaient tre
mal re us. En effet, d s qu'elle avait
eu connaissance de la venue des missaires britanniques, la r sidence généle,
par les soins de Morize, avait tout fait pour contrer le d placement. Il lui fallait d sormais emp cher toute
rencontre. Les larmes aux yeux , Morize informa Duff Cooper qu'il lui serait
interdit de voir les parlementaires du Massilia: Si le génél Nogu s me
demande de me tuer, je serais heureux d'ob ir.
Les ordres qu'il m'a donn s sont malheureusement plus cruels , commenta
Morize pour se justifier d' tre tenu de les ex cuter". Ce qui signifiait pour Duff Cooper que Morize
consid rait qu'il avait traiter les anciens ministres fran ais pratiquement
comme des prisonniers . 19 h 15, ordre fut donn toutes les autorit s de
faire obstacle toute communication entre Duff Cooper et les passagers du
Massilia. Conscients qu'il n'y avait
rien faire, Duff Cooper et lord Gort devaient donner leur parole d'honneur de
ne pas tenter de rencontrer les ministres, notamment celui pour lequel ils
taient venus, Mandel, qui tait pour eux the best of the ministers (le
meilleur parmi les ministres). Duff
Cooper, par l'interm diaire du consul de Rabat, adressa cependant ce dernier
un message chiffr lui disant qu'il ferait tout pour l'aider partir et que,
s'il le fallait, il enverrait m me un navire le lendemain de Gibraltar".
Tandis que Mandel surveillait sur le quai le
transport de ses bagages, il vit arriver la voiture du consul anglais
Casablanca, Bond. Il venait l'informer
de l'arriv e de Duff Cooper et du d sir qu'avait manifest le ministre anglais
de le rencontrer. Mandel acquies a avec empressement:
Ministre ami d'un pays alli [...] je le recevrai aussit t , devait-il
reconna tre. Mais il avait t invit
passer la nuit bord. Compte tenu
de l'heure d'arriv e de Duff Cooper, il lui faudrait une autorisation pour
rentrer dans le port apr s 20 h. Mandel demanda alors l'autorisation n cessaire
la venue de Duff Cooper sur le port.
L'autorisation sollicit e fut refus e par le commissaire de police du
port, qui l'invita regagner sa cabine.
Des ordres t l phoniques avaient t donn s par Morize 20 h 45. Ses
bagages sont d j descendus? Il faut les
remonter. S'il demande quelque chose,
dites-lui que c'est un ordre du r sident génél et pour sa s curit
personnelle ... Depuis le commissariat sp cial du port, Mandel appellera bien
Morize. Mais celui-ci refusa de lui
parler et fit r pondre par le standard qu'il n'avait rien ajouter. Il avait d j donn l'ordre d'emp cher Mandel
par tous moyens, y compris la force, de descendre terre et de t l phoner .
Mandel ne dormirait pas l'h tel Transatlantique. Mandel ne rencontrerait pas Duff Cooper. Cette suspension des communications avait t
assortie d'une pr caution suppl mentaire.
Non seulement Georges Mandel devrait passer la nuit bord, mais le
bateau serait loign du quai.
Le soir m me de ce 25 juin, le commandant Ferbos
recevait l'ordre d'aller mouiller l'aube en grande rade. Le lendemain, sept heures, le Massilia
jetait l'ancre plusieurs milles au large.
Mais, d s l'aube, Duff Cooper et lord Gort, surveill s sans r pit ni
m nagement par la police au cours de la nuit, taient repartis vers Gibraltar
sans avoir rencontr Mandel.
Le 25 juin 1940, le services des Affaires
trang res Bordeaux avait re u de Morize puis Nogu s successivement trois
t l grammes.
La premi re d p che de Morize (n 406-41 1)
inexactement dat e du 25 juin 0 h 45 (en fait le 26) informait le
gouvernement de Bordeaux de l'annonce par le consul génél Hurst de la venue
Rabat de Duff Cooper, puis de son arriv e 19 h 30 sur le Bou-Regreg, et de
l'interdiction faite par le secr taire génél de la r sidence de toute
relation avec les d put s arriv s Casablanca sur le paquebot Massilia . La
premi re d p che de Morize tait r v latrice: elle fixait les contours de la
conversation qu'il avait eue peu apr s son arriv e Rabat avec Duff Cooper. Le cabinet britannique, mis au courant de
l'arriv e de personnalit s politiques fran aises au Maroc le 24 au soir, avait
d cid d'envoyer Cooper Rabat afin, rapportait Morize, d'examiner avec ces
personnalit s et en particulier M. Mandel, les voies et moyens de continuer la
r sistance dans l'Afrique du Nord fran aise . Morize, qui, aupr s de ses
sup rieurs, d clarait avoir fait entendre la plus nergique des protestations
et qualifiait les passagers du Massilia de personnalit s sans mandat ou
de voyageurs de passage inattendus , avait obtenu la parole de Duff
Cooper de ne pas chercher nouer des relations avec M. Mandel . Il
poursuivait en des termes dubitatifs, qui cependant d signaient d j Mandel
comme un coupable: Ce parlementaire me para t tre le seul ancien ministre
qu'il souhaitait approcher. Il semblait
m me ne pas savoir le nom des autres passagers du Massilia.
Dat du
lendemain 26 et, en fait, exp di le
m me jour, un second t l gramme de Morize (n 412) indiquait avec soulagement
aux services de Baudouin qu'au lever
du jour l'hydravion britannique tait reparti pour Gibraltar apr s un
incident nocturne au cours duquel lord Gort avait t malmen par un des
inspecteurs charg s de l surveiller. Morize affirmait en outre avoir acquis la
conviction que lord Gort avait pris place dans l'hydravion pour se rendre
Gibraltar mais qu'il n' tait pas associ la mission de Duff Cooper.
Ce m me 26 juin, enfin, jour de son arriv e en
avion Rabat, Nogu s confirma les t l grammes de son subordonn en mettant en
exergue les mesures qu'il avait prises: J'ai fait savoir M. Georges Mandel,
par l'entremise du général Michel, qu'au premier incident et la moindre
d marche qu'il tenterait pour se mettre en relation avec les autorit s
consulaires anglaises, je n'h siterai pas le faire arr ter. Cette
d claration tait doubl e d'une accusation que Morize lui-m me n'avait pourtant
os prof rer: D s son arrivée Casablanca, l'ancien ministre de l'Int rieur
s'est mis en rapport avec les consulats britanniques et [... ] le ministre de
l'information a entrepris son d placement son instigation. Ainsi, d s le
26juin, sous la plume de Nogu s l'accusation avait pris corps: c'est Mandel qui
avait fait venir la mission britannique.
Les trois t l grammes allaient constituer les trois seules pi ces de
l'information pour atteinte la s ret ext rieure de l' tat .
Le 26 juin 15 h 30, le cabinet du Mar chal
crivit Nogu s: Je vous f licite vivement de l'attitude que vous avez prise
et des mesures que vous avez adopt es.
Le mar chal P tain est d'accord pour que le Massilia soit priv de
communication avec l'ext rieur".
Le 27 juin au matin, alors que le Massilia, d s la
veille au soir, avait t conduit sans tre accost en face du quai aux huiles,
les op rations de d barquement des passagers pouvaient commencer. Le bateau tant amarr par l'arri re au quai
des phosphates, les chaloupes devaient faire la navette entre l' chelle de
coup e et le quai, sur lequel la foule grossissait. Tout le monde peut descendre, sauf M.
Mandel... M. Mandel reste... avait ordonn le responsable des op rations de
d barquement. Vers dix heures, enfin,
une chaloupe plus grosse que les autres se pr senta. Un inspecteur de police monta bord et
invita Mandel le suivre. Les autres
passagers pr sents comprirent qu'il s'agissait d'une arrestation. Mandel, imp n trable, subit les hu es des
marins et descendit. Il tenait dans ses
bras la statuette en bronze du Clemenceau qui m prise et accuse , comme un
d fi aux hu es qu'il entendait.
Dans le bureau du Doyen, la Facult de droit,
Place Pey Berland, Paul Baudouin crit
la date du jeudi 27 juin: Laval a d cid , tant donn les nouvelles du Maroc
o M. Mandel s'est compromis avec les repr sentants britanniques et avec le
ministre britannique de l'information, tant donn aussi les appels lanc s par
radio, Londres, par le génél de Gaulle, d'ouvrir une information pour
complot contre la s ret de l' tat. Il
lui apparut indispensable de compl ter cette mesure par un changement de
titulaire dans le portefeuille du minist re de l'int rieur
De fait, le m me jour, Laval demandait la
nomination de Marquet l'int rieur. Le 4 juillet, le nouveau ministre de
l'int rieur fera t l graphier Alger: Maintenir pour M. Mandel r gime
ant rieurement fix . Selon Henri du Moulin de Labarth te, chef de cabinet du
mar chal P tain, les pires ennemis de Mandel, allaient tre Laval, Marquet
et Alibert". Il oubliait Weygand.le
8 juillet, le génél Weygand, ministre de la Guerre enverra Alger le t l gramme suivant (n] 211 S.P.) :
Comme
suite vos diff rentes communications relatives certains agissements de
parlementaires, faites imm diatement ouvrir devant le tribunal militaire
permanent de Casablanca une information contre X... pour atteinte la s ret
ext rieure de l' tat.
cet ordre tait ajout e une recommandation
pressante:
Cette
information pourra tre transform e d s la cl ture de la session parlementaire par
une information visant express ment M. Mandel.
Vous
inviterez galement le Commissaire du gouvernement faire une enqu te sur la
possibilit de poursuivre l'ensemble des men es accomplies en Angleterre par le
colonel (sic) de GAULLE, et qui paraissent devoir rejoindre directement
l'action menée par la personnalit parlementaire sus-vis e".
Tout était devenu clair: c' tait bien avant le 18
juin qu'il fallait partir. Mandel ne
pourrait plus partir. L'Angleterre
elle-m me se r signait. Le lendemain, 28
juin, le gouvernement de Sa Majest , apr s dix jours d'h sitation, se r solvait
reconnaître le général de Gaulle comme le chef de tous les Fran ais
libres". Longtemps apr s,
Marrakech, en janvier 1944, Churchill d plorera encore: Ah! Si j'avais pu faire
sortir Mandel en juin 1940.
[ ]
Bordeaux-Vichy
[ ]
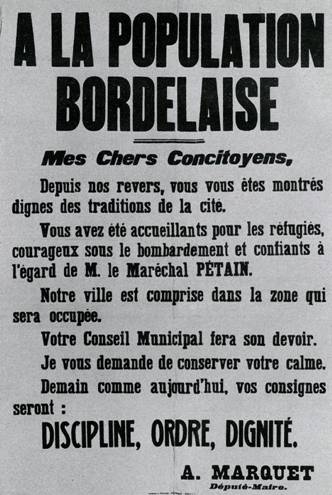
L'appel d'Adrien Marquet la population
bordelaise. 27 juin 1940.
[ ]
Il n'y a plus rien faire
Bordeaux. Une des premi res cons quences de l'armistice est que Bordeaux est en
zone occup e. Bordeaux n' tait certes qu'une solution provisoire. On a feint un
temps de croire que l'on pourrait retourner Paris. L'article 3 de la
"convention d'armistice" pr voyait que le gouvernement fran ais tait
"libre". On retrouve un espoir dans le fait que les allemands ont
voqu un d senclavement d'Orl ans de la zone occup e pour y installer les
pouvoirs publics. Mais cela n'a dur que le temps de quelques phrases de
circonstances lors des pourparlers d'armistice.
Le Conseil des Ministres du 26 examine
la situation : pour Pomaret "Marseille ne peut pas s rieusement tre
retenue. Certains sugg rent Toulouse, mais la ville est jug e
"excentrique" (sic) au
sein de l'hexagone m tropolitain qui n'existe plus en tant que tel depuis la
veille 0 heure 35. De surcro t,
c'est le fief des fr res Sarraut et de la D p che que r cusent Laval et ses
partisans. Il y a bien Lyon, la plus grande ville de la zone non occup e, mais
pour Laval, Lyon n'est pas une "ville favorable au gouvernement". Marquet,
moins malin que Laval, en donne la raison : " cause d'Herriot". D s
le 25, Laval se prononce en faveur de Vichy. Ce m me 26 juin, P tain a
bien dit Pomaret : "Pomaret,
t chez d' viter Vichy". Mais la r serve est de pure forme : la cit a
une connotation thermale et ludique : "Si nous allons Vichy, on dira,
en France et l' tranger, que nous sommes dans un gouvernement de
casino."
L'int r t se porte alors sur
Clermont-Ferrand : position centrale, liaisons routi res et ferroviaires,
population calme, fiabilit du Pr fet Peretti de la Roca, h tels de Royat
proches. Laval est s nateur du d partement, il ne peut qu'opiner. Le
probl me est que, le 26 juin, dans leur avance, les allemands y sont d j . Le
Pr fet y est gard vue dans ses appartements. Comme Toulouse, la ville est
envahie par les r fugi s. Il faudrait
2.000 gardes mobiles et 40.000 litres d'essence pour faire vacuer les
r fugi s. Pomaret a bien une solution subsidiaire : la Bourboule. Il faut se
rendre aux r alit s, Weygand rejoint Laval qu'il n'aime pas - pour le choix
de Vichy. Il y tait d'ailleurs le 13 juin au matin, l'H tel du Parc.
Le samedi 29 juin la ville se vide
subitement. A l'aube, un convoi se
forme. Une voiture dans laquelle se trouve Albert Lebrun a franchit les portes de
l'h tel du Pr fet, rue Vital-Carles Elle est partie pour Royat, par Brive,
Tulle et Ussel. Le Mar chal est parti la veille en claireur pour s'installer
directement Vichy. Et, en ce samedi, c'est au tour du gouvernement et des
administrations. Avant de s' loigner le nouveau ministre de l'Int rieur, Adrien
Marquet, a fait ses adieux sa ville qui n'est plus capitale. Il a confi ses
pouvoirs son premier adjoint, Pin dre. Lui, part pour l'accomplissement de
son destin national Vichy. Les parlementaires, les fonctionnaires des grandes
administrations et al foule des suiveurs de tout acabit qui d j les avaient
escort s jusqu' Bordeaux, prennent d'assaut la gare Saint Jean destination
de Clermont-Ferrand. Le thermom tre fr le les 30 mais l' d me urbain se r sorbe progressivement. A
leur r veil les Bordelais apprennent que les voitures de juin sont parties et
que les Allemands vont entrer dans la ville.
C'est le 29 juin, au petit jour,
"un petit jour sale de guillotine", que les corps constitu s avaient
rendez-vous pour quitter Bordeaux ("cette belle ville d sormais assombrie,
selon Paul-Boncour). Les Allemands ont exig un convoi pour en assurer le
contr le. On part donc en plusieurs caravanes : celle du gouvernement, celle
des administrations, celle du Corps Diplomatique et de la cohorte qui les suit
depuis Paris. Pour les parlementaires, le point de concentration est au
monument des girondins. L immense convoi d un millier de camions s est form
sur la place des Quinconces avant de s' tirer vers l Est. Le rythme des d parts
tait fix . Chaque voiture avait une place dans la longue procession, pr vue
l'avance.
Une caravane de voitures est
form e au pont de pierre, escort par des motocyclistes de l'arm e allemande.
Le long d fil sans gloire d'un gouvernement. Il a travers le pont de pierre
entre deux rang es d'uniformes feldgrau. Rompant la discipline, certains n'ont
pu s'emp cher de - mal - dissimuler des cam ras pour filmer leur trange
victoire aussi rapide qu'inattendue.
Puis, le triste cort ge a pris la
direction des quatre pavillons puis de Libourne. Des soldats allemands r glent
la circulation en direction de P rigueux en agitant imp rativement leur disque
rouge. Des d p ts d'essence jalonnaient la route. A Libourne, sur la place Abel
Surchamp, des officiers font claquer leurs bottes au passage du cort ge. A
Montpon sur l'Ile, c'est le point de passage entre les deux zones. Il y a d j
le barrage de fortune avec une chicane qui mat rialise la ligne de d marcation
entr e en vigueur le 24 juin minuit, moins de cinq jours plus t t.
"Jamais depuis l'exode,
les routes n'avaient t moins encombr es et la discipline mieux observ e"
relève Paul-Boncour. Il y a quand m me tout le long
de la route et tous les cent cinquante m tres des voitures abandonn es bout
d'essence, renvers es sur le bas c t , les roues en l'air, les pneus enlev s.
Les villages sont encombr s de soldats sans arme. Apr s Montpon, la colonne
s' tira et se dispersa, parfois, elle se scinda. Les voitures du génél
Weygand et des officiers d' tat-major prirent la direction de Bergerac pour une
br ve halte sur l'a rodrome de Piquecaillou o avait t organis e une remise
de d coration en pr sence du Général Georges...
Le 29 juin au matin, la petite
Gironde a annoncé en gros caract&egrav;res : "le gouvernement à quitté
Bordeaux", puis en plus petit, "pour s'installer
provisoirement dans le Massif Central. Et la Petite Gironde d'ajouter :
"Les parlementaires ont accompagné le gouvernement : ils continueront
collaborer avec lui dans les m mes conditions et avec le même esprit qu'
Bordeaux". En page int rieure, le S nateur René Caillet célébrait la
vertu de La Fontaine le plus national de nos crivains :
Travaillez, prenez de la
peiner et exaltait la
France mutil e et r g n r e par le travail. La patrie et le
travail. Paul-Boncour
notait : Et le cortège qui s'en allait vers Vichy d roulant son long ruban
travers les plaines de Gascogne et les montagnes d'Auvergne, par son ordre
comme par sa destination, ressemblait un peu un convoi de fun railles : les
fun railles de la R publique . Le
gouvernement de Bordeaux ne deviendra pas le régime de la Bourboule mais celui
de Vichy.
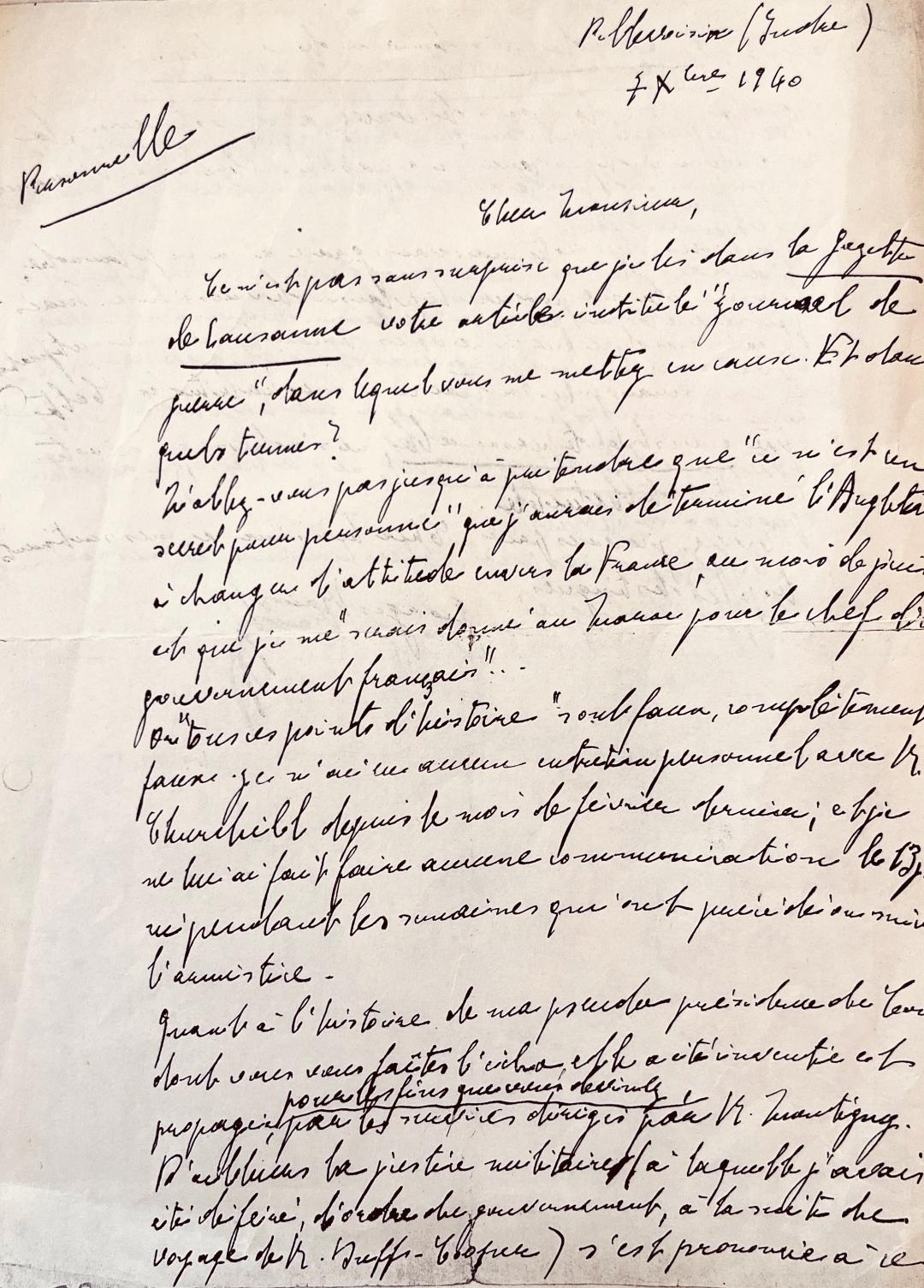
Lettre de Georges Mandel envoyée depuis Pellevoisin à la Gazette de Lausanne le 7 décembre 1940 (recto-Collection particuli&egrav;re)
Copyright Bertrand Favreau. Reproduction interdite.
Lire aussi :
*Les notes de l'appareil critique ne figurent pas dans le pr sent
extrait.
Copyright
Bertrand Favreau. Reproduction interdite.